par Serge Heughebaert
 C’était un soir d'hiver assez triste. Il y a presque deux ans. Dans sa librairie Le Rameau d'Or, Dimitri n'avait autour de lui que très peu d'écrivains dont j'étais et pratiquement aucun journaliste. On était loin, très loin de ces soirées d'autrefois où l’on était assis, fesse à fesse, pour présenter nos bouquins dans un espace qui manquait. Dans cette librairie, il faisait bon se faire voir alors, du monde de la plume et des médias.
C’était un soir d'hiver assez triste. Il y a presque deux ans. Dans sa librairie Le Rameau d'Or, Dimitri n'avait autour de lui que très peu d'écrivains dont j'étais et pratiquement aucun journaliste. On était loin, très loin de ces soirées d'autrefois où l’on était assis, fesse à fesse, pour présenter nos bouquins dans un espace qui manquait. Dans cette librairie, il faisait bon se faire voir alors, du monde de la plume et des médias.  Haldas avait sa cour. Frochaux était en verve. On picolait gaiement autour d’assiettes de chips.
Haldas avait sa cour. Frochaux était en verve. On picolait gaiement autour d’assiettes de chips.
Moi, j’étais assis à côté du peintre Appia et n’en revenais pas. J’étais là pour Cat’s Bay, mon premier roman à l’Àge d’Homme.
Des années plus tard, presque plus personne. Quelques auteurs, certains fiers de leurs talent, d’autres désabusés, entretenaient une conversation pour conjurer l’absence de tous les autres.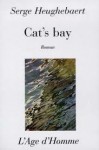 Pas un seul journaliste. Tatoué ou non. Du moins, au moment où j’y étais.
Pas un seul journaliste. Tatoué ou non. Du moins, au moment où j’y étais.
J’étais arrivé assez tôt. Et reparti le dernier. Fâcheuse tendance à l’ennui, mais persévérant. Notamment dans les impasses. Dimitri étais assez seul, debout, à un bout de table. Moi pareil, à l’autre bout. Il est venu vers moi et m’a parlé de Chessex qu’il avait édité avant les autres. De son projet de sortir les œuvres complètes de Cingria après l'avoir fait connaître une première fois. Et il m'en cita d'autres que je ne connaissais pas ou très peu. Puis enfin de Simenon qu’il vénérait. J’adore Simenon. On évoqua son style, sa lucidité, son humanité. Sa mère aussi, qu’il était allé rencontrer à Liège. Les mères d’écrivains… J’avais pour ami Bazin…
Le temps avait passé, il ne restait presque plus personne, et nous en étions encore à la froideur des sentiments. Au manque de reconnaissance. Nous étions maintenant les derniers dans la boutique. Je devais rentrer à Bienne. Il m’a serré la main. Il avait l’œil embué, ce qui m’étonna. Je ne connaissais pas cette sensibilité à celui qui se voulait sans mollesse. Au moment de partir, il me dit ce qu’il a dit à tant d’autres : On continue !
Je n’oublierai jamais ce soir d’hiver, cette solitude, cet œil. On continue…
Et puis l’accident. Stupide comme tous les accidents, même s’ils comportent parfois une fatalité.
Et maintenant Jean-Michel, duquel il m’avait dit, avant son prix : vous verrez, il peut faire encore mieux s’il se lâche…
Enfin, demain, peut-être, Dicker au Goncourt après le prix de l’Académie.
On continue…
 De son nuage, il doit sourire, de toutes les manigances, les simagrées, les sourires hypocrites, les éloges funèbres, le Barbare qui fut si longtemps blacklisté par les journaux français, comme suisses, pour ses « opinions politiques », lui qui surtout fut le passeur des plus grands textes russes (Grossman, Zinoviev), slaves (Tsernianski), mais aussi romands (Haldas, Barillier, Vuilleumier, Monique Laederach, Bernadette Richard, Fontanet, Kuffer, Frochaux, Albanese et tant d'autres), il doit sourire aux articles des demoiselles du Temps qui s'extasient sur le « renouveau des lettres romandes », alors qu'il l'annonçait depuis 30 ans, ce renouveau, et qu'elles n'ont rien vu venir (et pour cause, elles ignoraient ses livres), il doit sourire, entouré de ses popes aux longues barbes, de tous ces brusques revirements, lui qui a enduré insultes, mépris et silences gênés, il a fallu qu'il meure pour qu'on ose à nouveau prononcer son nom : Dimitri.
De son nuage, il doit sourire, de toutes les manigances, les simagrées, les sourires hypocrites, les éloges funèbres, le Barbare qui fut si longtemps blacklisté par les journaux français, comme suisses, pour ses « opinions politiques », lui qui surtout fut le passeur des plus grands textes russes (Grossman, Zinoviev), slaves (Tsernianski), mais aussi romands (Haldas, Barillier, Vuilleumier, Monique Laederach, Bernadette Richard, Fontanet, Kuffer, Frochaux, Albanese et tant d'autres), il doit sourire aux articles des demoiselles du Temps qui s'extasient sur le « renouveau des lettres romandes », alors qu'il l'annonçait depuis 30 ans, ce renouveau, et qu'elles n'ont rien vu venir (et pour cause, elles ignoraient ses livres), il doit sourire, entouré de ses popes aux longues barbes, de tous ces brusques revirements, lui qui a enduré insultes, mépris et silences gênés, il a fallu qu'il meure pour qu'on ose à nouveau prononcer son nom : Dimitri. Ce matin, je suis allé courir au bord de l’océan, de Santa Monica à Venice, Californie, un peu moins de dix kilomètres. Il faisait beau. L’air était pur. Ici, le ciel ne connaît pas l’orage. Des SDF, emmitouflés dans leur sac de couchage, dormaient sur le sable rincé par les marées. Des surfeurs jouaient à taquiner les vagues. Non loin d’ici, à Santa Barbara, l’un d’eux s’est fait croquer par un requin. Aujourd’hui, je ne me baignerai pas.
Ce matin, je suis allé courir au bord de l’océan, de Santa Monica à Venice, Californie, un peu moins de dix kilomètres. Il faisait beau. L’air était pur. Ici, le ciel ne connaît pas l’orage. Des SDF, emmitouflés dans leur sac de couchage, dormaient sur le sable rincé par les marées. Des surfeurs jouaient à taquiner les vagues. Non loin d’ici, à Santa Barbara, l’un d’eux s’est fait croquer par un requin. Aujourd’hui, je ne me baignerai pas. Il faut venir ici, dans ce jardin d’Eden, pour rencontrer des étudiants passionnés de lecture, des découvreurs et des passeurs qui cherchent tous les jours à faire partager leur enthousiasme pour les littératures francophones. À UCLA, j’ai fait la connaissance de Jean-Claude Carron (à gauche), valaisan d’origine, genevois par ses études et professeur émérite de littérature française à Los Angeles.
Il faut venir ici, dans ce jardin d’Eden, pour rencontrer des étudiants passionnés de lecture, des découvreurs et des passeurs qui cherchent tous les jours à faire partager leur enthousiasme pour les littératures francophones. À UCLA, j’ai fait la connaissance de Jean-Claude Carron (à gauche), valaisan d’origine, genevois par ses études et professeur émérite de littérature française à Los Angeles.  Et j’ai retrouvé mon ami Alain Mabanckou, poète et romancier franco-congolais, qui enseigne également dans la Cité des Anges. Il faut venir ici, à l’autre bout du monde, pour évoquer les noms de nos Pères : Ramuz, Cendrars, Haldas, Bouvier — et tant d’autres. Et que ces noms suscitent une attente, une émotion, un vrai désir de donner sens au monde. Un désir et une curiosité qui n’existent plus, hélas, dans nos universités en état de mort cérébrale.
Et j’ai retrouvé mon ami Alain Mabanckou, poète et romancier franco-congolais, qui enseigne également dans la Cité des Anges. Il faut venir ici, à l’autre bout du monde, pour évoquer les noms de nos Pères : Ramuz, Cendrars, Haldas, Bouvier — et tant d’autres. Et que ces noms suscitent une attente, une émotion, un vrai désir de donner sens au monde. Un désir et une curiosité qui n’existent plus, hélas, dans nos universités en état de mort cérébrale. Une limousine s’arrête un peu plus loin. Un couple d’acteurs
Une limousine s’arrête un peu plus loin. Un couple d’acteurs