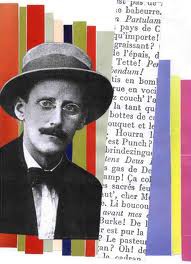Écrire un texte, c’est tisser une étoffe. D’ailleurs, les mots texte et tissuont la même étymologie. C’est pourquoi, depuis Homère, Pénélope est la mère des écrivains, elle qui remet cent fois l’ouvrage sur le métier et s’amuse à défaire, la nuit, ce qu’elle a tissé pendant le jour, en attendant son Ulysse de mari qui vagabonde et fait des galipettes.
Écrire un texte, c’est tisser une étoffe. D’ailleurs, les mots texte et tissuont la même étymologie. C’est pourquoi, depuis Homère, Pénélope est la mère des écrivains, elle qui remet cent fois l’ouvrage sur le métier et s’amuse à défaire, la nuit, ce qu’elle a tissé pendant le jour, en attendant son Ulysse de mari qui vagabonde et fait des galipettes.
Écrire, c’est tisser, et tisser, depuis les temps les plus anciens, est l’apanage des femmes. Avant même l’invention du tissu (pour se protéger du froid, puis pour cacher les « parties honteuses »), les femmes avaient le goût, pour elles-mêmes et sans doute aussi pour le plaisir de leur(s) amants(s), de tisser les poils de leur toison pubienne.
Ce n’est pas moi qui le dis, mais Sigmund Freud, un médecin viennois qui a réussi…
Les femmes ont inventé le tissage, et par conséquent l’écriture. On apprend aujourd’hui que ce sont elles, de surcroît, qui auraient peint les bouleversantes fresques des grottes de Lascaux — et non ces hommes du paléolithique, barbus et assoiffés de viande fraîche. Ces fresques qui marquent, par leur fantasmagorie bariolée, la véritable invention de l’art (16'000 ans avant notre ère).
Quelle découverte !
Après de longues recherches, l’archéologue Dean Snow, de l'Université de Pennsylvanie, est arrivé à la conclusion que 75% des peintures de bisons, mammouths, chevaux et autres cerfs capturés par des hommes, avaient été réalisées par des femmes. Comment en être sûr ? L’empreinte des mains, la longueur des doigts et leur écartement correspondent précisément à des mains de femmes.
Est-ce une surprise ? Non, répond le chercheur :  « Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ce sont les hommes qui tuent. Mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui rapportent les proies au camp. Elles sont donc autant concernées par la chasse que les hommes. »
« Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ce sont les hommes qui tuent. Mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui rapportent les proies au camp. Elles sont donc autant concernées par la chasse que les hommes. »
Ce n’est pas une surprise, donc. Pourtant, comme c’est curieux, personne ne l’avait suggéré auparavant. Croyait-on les femmes incapables de peindre ou d’écrire ? Les avait-on déjà confinées, à l’aube des temps, aux fourneaux et aux tâches ménagères ? Les paléontologues ne seraient-ils pas un peu machistes ?
Freud dirait que tout cela est normal : étant à l’origine de toute vie, la Créatrice par excellence, la Femme-Mère a inventé les arts dans la même foulée. La musique, par sa voix mélodieuse. L’écriture, par son tissage habile. Et la peinture, grâce à ses petites mains magiques.
Que nous reste-t-il alors, à nous autres, qui n’avons rien inventé ?
La guerre ? Le bricolage ? Le fameux muscle Heineken ?
Les hommes sont condamnés, depuis toujours, aux seconds rôles. Des faire-valoir. Des followers, comme ont dit aujourd’hui…
Il fallait un chercheur américain au nom de neige, Dean Snow, pour enfoncer le clou et nous rappeler à notre humble condition.