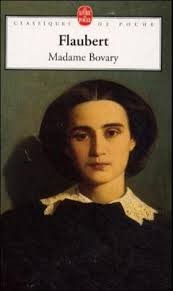Souvent, dans la littérature romande, on respire mal. L’air y est rare. Quelquefois on étouffe. Il y a des barreaux aux fenêtres. Des murs partout. La porte est verrouillée de l’intérieur. Et même, parfois, une corde est préparée au salon pour se pendre. Le monde entier se limite à une chambre. Pourquoi écrire ? Comment sortir de sa prison ?
 Dans son dernier livre, Jon Ferguson, peintre, écrivain et coach de basket (il a entraîné à peu près tous les clubs de Suisse romande) prend le problème à rebrousse-poil. Et si la vraie libération, justement, passait par la prison ? Et si, pour devenir enfin celui qu’on pressent être, il fallait lâcher prise, comme on dit, se réfugier dans le silence et se faire interner ?
Dans son dernier livre, Jon Ferguson, peintre, écrivain et coach de basket (il a entraîné à peu près tous les clubs de Suisse romande) prend le problème à rebrousse-poil. Et si la vraie libération, justement, passait par la prison ? Et si, pour devenir enfin celui qu’on pressent être, il fallait lâcher prise, comme on dit, se réfugier dans le silence et se faire interner ?
C’est l’étrange expérience que Ferguson raconte dans La dépression de Foster*, un roman bref et incisif, qui se passe en Californie, où l’auteur est né en 1949. Un matin, Foster aperçoit sur la route un serpent mort, écrasé par une voiture. Deux jours plus tard, le serpent a disparu, mangé par un autre animal ou lavé par la pluie. Cet événement banal va déclencher chez Foster une crise profonde, aussi brutale qu’inattendue. Il s’enferme dans le silence. Il fait le vide en lui. Peu à peu, il se déconnecte du monde des vivants.
Dans l’asile où on l’interne, il mène pendant 18 mois une vie de Chartreux, refusant d’adresser la parole à quiconque. Il n’est pas malheureux.  Au contraire, médecins et infirmières sont aux petits soins. Il mange à heure régulière. Il fait de longues promenades dans le parc. Il reçoit de temps à autre la visite de sa première épouse. Sa seconde femme, Glenda, vient également le visiter, avec sa petite fille, Gloria. Elles se doutent de quelque chose. Mais quoi ? Foster est-il vraiment fou ou joue-t-il la comédie de la folie ? Et pourquoi garde-t-il le silence ?
Au contraire, médecins et infirmières sont aux petits soins. Il mange à heure régulière. Il fait de longues promenades dans le parc. Il reçoit de temps à autre la visite de sa première épouse. Sa seconde femme, Glenda, vient également le visiter, avec sa petite fille, Gloria. Elles se doutent de quelque chose. Mais quoi ? Foster est-il vraiment fou ou joue-t-il la comédie de la folie ? Et pourquoi garde-t-il le silence ?
 On reconnaît, ici, les interrogations du philosophe. Car Ferguson, en grand sportif, est féru de philosophie — Nietzsche en particulier, auquel il a consacré un petit livre**. Et le serpent qui provoque la crise de Foster ressemble au cheval maltraité qui plongea Nietzsche dans la démence, un certain jour de janvier 1889, à Turin. À partir de ce jour, le philosophe allemand ne prononça plus un mot, se contentant de jouer et chanter de la musique.
On reconnaît, ici, les interrogations du philosophe. Car Ferguson, en grand sportif, est féru de philosophie — Nietzsche en particulier, auquel il a consacré un petit livre**. Et le serpent qui provoque la crise de Foster ressemble au cheval maltraité qui plongea Nietzsche dans la démence, un certain jour de janvier 1889, à Turin. À partir de ce jour, le philosophe allemand ne prononça plus un mot, se contentant de jouer et chanter de la musique.
Un psychologue, humain, plus qu’humain, va débrouiller les fils de sa folie et sortir Foster de son mutisme. Reprenant la parole, Foster devient « normal ». Il peut réintégrer le monde des humains, même si, au fond de lui, il est cassé. Il renoue avec sa famille (qui marche très bien sans lui). Il retrouve Maria, l’infirmière mexicaine qui venait le retrouver dans sa chambre, la nuit, pour lui prodiguer des gâteries. Il devient cuisinier dans un fast-food.
Que de questions, dans ce petit roman provocant et léger, sur la folie, la destinée humaine, le mariage, la dépression, le bonheur sur la terre !
« Nous naissons tous fous ; quelques-uns le demeurent », écrivait Beckett. C’est le destin de Ted Foster, qui a traversé le silence, pour devenir lui-même.
* Jon Ferguson, La Dépression de Foster, roman, Olivier Morattel éditeur, 2013.
** Jon Ferguson, Nietzsche au petit-déjeuner, L’Âge d’Homme, 1996.