 Sous ce titre biblique, l’écrivain Pierre Béguin (né à Genève en 1953) nous conte une drôle d’histoire, on ne peut plus moderne, qui est l’antithèse parfaite de la citation de l’Évangile (Mathieu 25 ; 13). Un soir, entre la poire et le fromage, presque en catimini, ses parents lui annoncent qu’ils vont bientôt mourir. Au seuil de la nonantaine, ils souffrent l’un et l’autre dans leur corps, comme dans leur âme, du déclin de leurs forces. Ce qui, après une vie de labeur, d’abnégation, de modestie et d’« honnêteté jusqu’à la naïveté », semble être dans la nature des choses. Ce qui l’est moins, et qui stupéfie le narrateur, c’est qu’ils lui donnent le jour et l’heure de leur mort : tous deux, après mûre et secrète réflexion, ont décidé de faire appel à Exit et ont fixé eux-mêmes la date de leur disparition : ce sera le 28 avril 2012 à 14 heures…
Sous ce titre biblique, l’écrivain Pierre Béguin (né à Genève en 1953) nous conte une drôle d’histoire, on ne peut plus moderne, qui est l’antithèse parfaite de la citation de l’Évangile (Mathieu 25 ; 13). Un soir, entre la poire et le fromage, presque en catimini, ses parents lui annoncent qu’ils vont bientôt mourir. Au seuil de la nonantaine, ils souffrent l’un et l’autre dans leur corps, comme dans leur âme, du déclin de leurs forces. Ce qui, après une vie de labeur, d’abnégation, de modestie et d’« honnêteté jusqu’à la naïveté », semble être dans la nature des choses. Ce qui l’est moins, et qui stupéfie le narrateur, c’est qu’ils lui donnent le jour et l’heure de leur mort : tous deux, après mûre et secrète réflexion, ont décidé de faire appel à Exit et ont fixé eux-mêmes la date de leur disparition : ce sera le 28 avril 2012 à 14 heures…
C’est le point de départ, si j’ose dire, du livre poignant de Pierre Béguin. Comment réagir face à la violence inouïe d’une telle annonce ? Faut-il se révolter ? Ou, au contraire, tenter de la comprendre et accepter, en fin de compte, l’inacceptable ? Quoi qu’il décide, le fils se trouve pris dans les filets d’une culpabilité sans fond. Soit il refuse d’entendre la souffrance de ses parents. Soit il se fait complice de leur suicide.
Ainsi, le fils se trouve un jour dans la position intenable du juge qui cautionne ou condamne la mort de ceux qui lui ont donné la vie. Mais de quel droit peut-il s’opposer à leur liberté essentielle ? Et que commande l’amour ? Abréger leurs souffrances ou les forcer, au nom de la morale chrétienne, à poursuivre leur chemin de croix ?
Aimer, c’est reconnaître à l’autre sa liberté, fût-elle mortelle. Le fils accepte donc cette mort programmée. Il revient dans la ferme familiale (son père est maraîcher). Il retrouve sa chambre d’enfant. Et, la veille du jour fatal, il se met à écrire. Une vie de rigueur et de discipline. De colères et d’humiliations. Dont la hantise, répétée maintes fois, était de tenir sa place et de ne jamais faire honte. Une vie de silence surtout. Un silence mortifère qui rongeait toutes les conversations.
Comme il est difficile de parler à son père ! Ou à son fils.
Alors, sur ce terrain miné, on échange des insultes. On joue de l’ironie. On distribue des gifles ou des coups de pieds au cul.
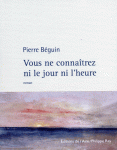 De manière admirable, Pierre Béguin revisite son passé. Il cherche à trouver l’origine de cette faille qui le sépare de ses parents. Comme Annie Ernaux**, il constate que cette faille est liée aux études : le père a quitté tôt l’école et le fils, en poursuivant les siennes, a trahi ses racines, et son milieu social. Et il a aggravé cette faille en voulant devenir écrivain. Ce que son père n’a jamais compris.
De manière admirable, Pierre Béguin revisite son passé. Il cherche à trouver l’origine de cette faille qui le sépare de ses parents. Comme Annie Ernaux**, il constate que cette faille est liée aux études : le père a quitté tôt l’école et le fils, en poursuivant les siennes, a trahi ses racines, et son milieu social. Et il a aggravé cette faille en voulant devenir écrivain. Ce que son père n’a jamais compris.
Au fil des heures, la mort s’approche. Inéluctable et pourtant désirée. Ils vont entrer, bientôt, dans le domaine des dieux.
Le fils assiste à leur départ. Il écrit pour ne pas pleurer. Il recueille leurs dernières paroles, leurs derniers gestes.
Il répare le silence.
* Pierre Béguin, Vous ne connaîtrez ni le jour ni l’heure, Éditions de l’Aire/ Philippe Rey, 2013.
** Annie Ernaux, La Place et Une Femme, Folio.
 Avec Roland Jaccard, c’est agréable, on ne perd pas son temps. D’emblée, il annonce la couleur. « Il m’est pénible de l’avouer, mais je suis un pauvre type. Je n’ai pas le souvenir de l’avoir toujours été. » Faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. Mais on connaît le zèbre. Cet aveu de faiblesse, comme souvent, est la première pièce d’un procès que l’auteur, livre après livre, s’intente à lui-même, suivant l’exemple de son frère de macération Henri Frédéric Amiel. Autocritique, cynisme, autodénigrement : ce sont les armes qu’utilise Jaccard avec, il faut le dire, non seulement une grande intelligence, qui confine parfois à la rouerie, mais aussi un style et une attitude (on n’osera pas parler d’éthique) : la suprême élégance des désespérés.
Avec Roland Jaccard, c’est agréable, on ne perd pas son temps. D’emblée, il annonce la couleur. « Il m’est pénible de l’avouer, mais je suis un pauvre type. Je n’ai pas le souvenir de l’avoir toujours été. » Faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. Mais on connaît le zèbre. Cet aveu de faiblesse, comme souvent, est la première pièce d’un procès que l’auteur, livre après livre, s’intente à lui-même, suivant l’exemple de son frère de macération Henri Frédéric Amiel. Autocritique, cynisme, autodénigrement : ce sont les armes qu’utilise Jaccard avec, il faut le dire, non seulement une grande intelligence, qui confine parfois à la rouerie, mais aussi un style et une attitude (on n’osera pas parler d’éthique) : la suprême élégance des désespérés. Son dernier livre, Ma vie et autres trahisons*, n’est pas un roman, ni un essai, ni une confession, mais les trois à la fois. Jaccard n’est jamais aussi passionnant que lorsqu’il mêle les genres, sans avoir l’air d’y toucher.
Son dernier livre, Ma vie et autres trahisons*, n’est pas un roman, ni un essai, ni une confession, mais les trois à la fois. Jaccard n’est jamais aussi passionnant que lorsqu’il mêle les genres, sans avoir l’air d’y toucher. Il n’y a pas de nostalgie de ces évocations d’un passé plus ou moins révolu, mais au contraire la tentative de saisir la grâce d’un moment d’abandon où les amants, délivrés de leur moi (c’est-à-dire de toute volonté de puissance) jouissent librement l’un de l’autre.
Il n’y a pas de nostalgie de ces évocations d’un passé plus ou moins révolu, mais au contraire la tentative de saisir la grâce d’un moment d’abandon où les amants, délivrés de leur moi (c’est-à-dire de toute volonté de puissance) jouissent librement l’un de l’autre. Des confessions ? Chaque ouvrage de Jaccard en est une à sa manière, qu’il s’agisse d’ouvrages « sérieux », comme La Tentation nihiliste ou L’Exil intérieur, ou de livres plus « légers », comme Des femmes disparaissent (mais Jaccard abolit ces distinctions factices entre les genres). Ma vie et autres trahisons n’échappe pas à cette règle. L’auteur se livre, avec humour et détachement, à une mise à nu — presque une exhibition — de ses fantasmes et de ses émotions. On pense ici à Amiel, le maître incontesté du journal intime (16'000 pages, quand même, pour dire le vide de sa vie genevoise), et surtout à Benjamin Constant, dont Jaccard est un fervent admirateur.
Des confessions ? Chaque ouvrage de Jaccard en est une à sa manière, qu’il s’agisse d’ouvrages « sérieux », comme La Tentation nihiliste ou L’Exil intérieur, ou de livres plus « légers », comme Des femmes disparaissent (mais Jaccard abolit ces distinctions factices entre les genres). Ma vie et autres trahisons n’échappe pas à cette règle. L’auteur se livre, avec humour et détachement, à une mise à nu — presque une exhibition — de ses fantasmes et de ses émotions. On pense ici à Amiel, le maître incontesté du journal intime (16'000 pages, quand même, pour dire le vide de sa vie genevoise), et surtout à Benjamin Constant, dont Jaccard est un fervent admirateur. 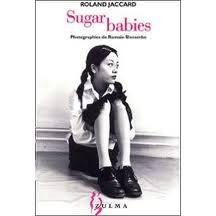 L’auteur ne raconte pas sa vie (pitié !). Il la découpe au scalpel, il retourne le couteau dans la plaie, il jette du sel sur ses blessures.
L’auteur ne raconte pas sa vie (pitié !). Il la découpe au scalpel, il retourne le couteau dans la plaie, il jette du sel sur ses blessures.
 On a le cœur noué, l’angoisse au bout des lèvres et l’on rit de ces tranches de vie déchaînées qui chaque fois nous plongent au fond d’une passion ordinaire et mortelle. Le ton est alerte ; la voix de chacune de ces femmes, singulière et reconnaissable. C’est une manière de tour de force que de montrer ainsi les fêlures de l’être humain, de creuser et de disséquer, sans jamais tomber dans le sordide ou le gratuit.
On a le cœur noué, l’angoisse au bout des lèvres et l’on rit de ces tranches de vie déchaînées qui chaque fois nous plongent au fond d’une passion ordinaire et mortelle. Le ton est alerte ; la voix de chacune de ces femmes, singulière et reconnaissable. C’est une manière de tour de force que de montrer ainsi les fêlures de l’être humain, de creuser et de disséquer, sans jamais tomber dans le sordide ou le gratuit.