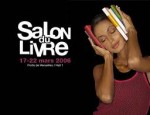 Les Salons du Livre, croyez-moi, c'est la barbe. Bruxelles, Paris, Genève : le topo est toujours le même. A moitié dissimulés derrière une pile de livres, les auteurs font l'article, comme les dames dans les vitrines, mais avec sans doute moins de succès. Chacun essaie de vendre ses charmes. Sourires. Paroles amènes. Regards accrocheurs. Parfois, ça marche. Le plus souvent, on en est quitte pour un long soliloque, au terme duquel le chaland (et bien plus souvent la chalande) repose le livre qu'il tient dans les mains (le vôtre, donc) et s'en va avec une moue dédaigneuse. Pendant ce temps, votre voisin de table, qui, lui, a signé quelques livres, vous regarde du coin de l'oeil en ricanant...
Les Salons du Livre, croyez-moi, c'est la barbe. Bruxelles, Paris, Genève : le topo est toujours le même. A moitié dissimulés derrière une pile de livres, les auteurs font l'article, comme les dames dans les vitrines, mais avec sans doute moins de succès. Chacun essaie de vendre ses charmes. Sourires. Paroles amènes. Regards accrocheurs. Parfois, ça marche. Le plus souvent, on en est quitte pour un long soliloque, au terme duquel le chaland (et bien plus souvent la chalande) repose le livre qu'il tient dans les mains (le vôtre, donc) et s'en va avec une moue dédaigneuse. Pendant ce temps, votre voisin de table, qui, lui, a signé quelques livres, vous regarde du coin de l'oeil en ricanant...
Mais faut-il rencontrer, à tout prix, les écrivains dont on aime les livres ? À part quelques fétichistes (dont je suis) toujours avides d'exemplaires dédicacés, qui peut bien s'intéresser aux auteurs ? La lecture n'est-elle pas ce plaisir solitaire, parfois même clandestin, qui exige du lecteur à la fois le silence, le secret et la solitude ?
Heureusement, dans les Salons, il y a les rencontres. C'est la seule et la meilleure raison de fréquenter les Salons du livre. A Paris, où j'étais vendredi et samedi, un parmi les 2000 (!) auteurs invités, j'ai eu la chance et le bonheur de retrouver mon ami Dany Laferrière (qui a adoré L'Amour nègre). Il revenait de Genève, où il avait été invité par la Maison de la Littérature avec d'autres écrivains haïtiens.  Il avait même été le rédacteur en chef d'un jour du supplément culturel du journal Le Temps, placé sous la direction d'Arnaud Robert, excellent journaliste. Dany était sur le stand canadien (vivant à Montréal, il a le passeport canadien) — de loin le stand le plus animé et le plus chaleureux du Salon. Nous avons beaucoup ri, échangé quelques livres, passé un moment épatant.
Il avait même été le rédacteur en chef d'un jour du supplément culturel du journal Le Temps, placé sous la direction d'Arnaud Robert, excellent journaliste. Dany était sur le stand canadien (vivant à Montréal, il a le passeport canadien) — de loin le stand le plus animé et le plus chaleureux du Salon. Nous avons beaucoup ri, échangé quelques livres, passé un moment épatant.
De retour au stand suisse, morne et silencieux comme Délémont après 10 heures du soir, une autre rencontre : Djémâa, collègue blogueuse de la Tribune. Je l'avais croisée une ou deux fois sans avoir le temps de parler avec elle. 
Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Par définition, les surprises, bonnes ou mauvaises, ne s'annoncent pas.
Elles étaient au rendez-vous du Salon de Paris — qui ressemble comme un frère à celui de Genève, en cinq fois plus grand. Grâce à Dany et à Djémâa,
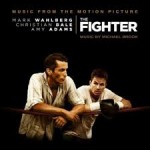 La vie est un combat. Le cinéma américain ne cesse de nous le rappeler. Le plus souvent, la boxe est la métaphore de ce combat. Cela donne Rocky (1, 2, 3…), Hurricane, et surtout Raging Bull, le chef-d'œuvre de Scorsese. Difficile à surpasser. Alors, en allant voir The Fighter, le dernier film de David O. Russel, je m'attendais à suivre l'itinéraire somme toute assez banal du boxeur d'origine pauvre qui parvient, grâce à son sport et sa ténacité, à sortir de sa condition et à être reconnu pour son talent. Sa pugnacité.
La vie est un combat. Le cinéma américain ne cesse de nous le rappeler. Le plus souvent, la boxe est la métaphore de ce combat. Cela donne Rocky (1, 2, 3…), Hurricane, et surtout Raging Bull, le chef-d'œuvre de Scorsese. Difficile à surpasser. Alors, en allant voir The Fighter, le dernier film de David O. Russel, je m'attendais à suivre l'itinéraire somme toute assez banal du boxeur d'origine pauvre qui parvient, grâce à son sport et sa ténacité, à sortir de sa condition et à être reconnu pour son talent. Sa pugnacité. La vie est un combat, certes. Contre soi-même, contre la société. Contre sa famille, d'abord. Il faut tuer son frère, dont l'ombre envahissante menace à chaque instant de vous engloutir. Il faut s'arracher aux griffes de sa mère qui préférera toujours son frère junkie parce qu'ainsi, shooté à mort, il n'échappe pas à sa toute-puissance castratrice . Oui, The Fighter est un film œdipien. Pour advenir à soi-même, il faut d'abord tuer les autres. Ceux qui sont le plus proches. Dans le film, Micky y parvient grâce à Charlene (délicieuse Amy Adams) qui l'aide à rompre les amarres.
La vie est un combat, certes. Contre soi-même, contre la société. Contre sa famille, d'abord. Il faut tuer son frère, dont l'ombre envahissante menace à chaque instant de vous engloutir. Il faut s'arracher aux griffes de sa mère qui préférera toujours son frère junkie parce qu'ainsi, shooté à mort, il n'échappe pas à sa toute-puissance castratrice . Oui, The Fighter est un film œdipien. Pour advenir à soi-même, il faut d'abord tuer les autres. Ceux qui sont le plus proches. Dans le film, Micky y parvient grâce à Charlene (délicieuse Amy Adams) qui l'aide à rompre les amarres.