 Certains livres ont la force d’un exorcisme. Ils prennent le mal à bras le corps, essaient de lui tordre le cou. Mais le combat se révèle inégal. Le mal est là, en soi et hors de soi. Il s’appelle déception, fascination pour le néant, douleur de vivre. L’amour, seul, peut lui tenir la dragée haute. Encore faut-il qu’il soit pur et profond !
Certains livres ont la force d’un exorcisme. Ils prennent le mal à bras le corps, essaient de lui tordre le cou. Mais le combat se révèle inégal. Le mal est là, en soi et hors de soi. Il s’appelle déception, fascination pour le néant, douleur de vivre. L’amour, seul, peut lui tenir la dragée haute. Encore faut-il qu’il soit pur et profond !
C’est le cas du dernier livre d’Anne-Sylvie Sprenger, née à Lausanne en 1977, dont le titre est déjà tout un programme : Autoportrait givré et dégradant*. Il raconte une histoire simple : une jeune femme qui veut se jeter sous un train, des amours improbables avec son sauveur, le conducteur de la locomotive, l’enfer qui s’installe lentement, la naissance d’un enfant naturel, la haine de sa belle-famille, la plongée à nouveau dans les eaux du désespoir. Le livre flirte constamment avec la mort. Heureusement Eros, le frère jumeau de Thanatos, n’est jamais loin. Judith, l’héroïne du roman, lui prête des pouvoirs magiques. Seul l’amour, pense-t-elle, peut la sauver. Non d’une faute que la jeune femme aurait commise. Mais, simplement, organiquement, de la souffrance d’être au monde.
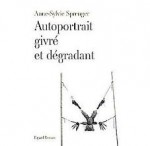 Car Judith croit trouver en Paul, le cheminot, son sauveur. En réalité, cet homme taciturne et sournois va l’entraîner dans la spirale de l’alcool. Bientôt, l’amour rêvé se transforme en cauchemar. Même le Sauveur porte le mal en lui, encouragé, comme dans une tragédie grecque, par le chœur des belles-sœurs qui poussent des cris d’orfraie. Judith, qui enseigne le français, tombe amoureuse de l’un de ses élèves et se retrouve enceinte. Paul, mari cocu, accepte cette situation honteuse. Mieux même : il tente de s’amender. Il cesse de boire, tente de reconquérir sa femme. Il réinvente, au fond de lui, l’amour des commencements. Mais le destin guette, qui va réduire à néant sa volonté de rédemption…
Car Judith croit trouver en Paul, le cheminot, son sauveur. En réalité, cet homme taciturne et sournois va l’entraîner dans la spirale de l’alcool. Bientôt, l’amour rêvé se transforme en cauchemar. Même le Sauveur porte le mal en lui, encouragé, comme dans une tragédie grecque, par le chœur des belles-sœurs qui poussent des cris d’orfraie. Judith, qui enseigne le français, tombe amoureuse de l’un de ses élèves et se retrouve enceinte. Paul, mari cocu, accepte cette situation honteuse. Mieux même : il tente de s’amender. Il cesse de boire, tente de reconquérir sa femme. Il réinvente, au fond de lui, l’amour des commencements. Mais le destin guette, qui va réduire à néant sa volonté de rédemption…
Inutile d’en dire davantage : tout le roman d’Anne-Sylvie Sprenger tient sur ce fil tendu, fragile, entre l’amour et la mort. Il est écrit en brefs chapitres entre lesquels, heureusement, le lecteur peut reprendre son souffle. Il en a bien besoin. Car l’histoire est intense et admirablement construite. On est emporté par le destin de Judith, sa souffrance, ses rêves de bonheur. On suit sa quête pas à pas, captivé par la force du désir. Et sa folie.
« Un roman est crédible, écrivait Jacques Chessex, quand son style lui donne corps. » C’est le cas d’Anne-Sylvie Sprenger, l’un des rares écrivains suisses-romands à posséder un style. Poétique, précis, unique, profond. Il faut lire ce roman, jusqu’au retournement final, où l’auteur se sauve, littéralement, en laissant derrière elle un manuscrit qui est la preuve de sa rédemption. Signe d’un exorcisme réussi.
* Anne-Sylvie Sprenger, Autoportrait givré et dégradant, roman, Fayard, 2012.
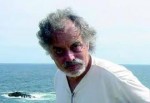 On connaît bien Jean-François Duval, grand reporter pour M Magazine (ses interviews de Nathalie Baye ou de Michel Houellebecq, par exemple, sont des morceaux d’anthologie…), spécialiste de Charles Bukowski et de la beat generation, mais aussi romancier de talent (Boston Blues, Phébus, 2000). Il se penche aujourd’hui sur ses années d’adolescence, dans un roman qui cherche à ressaisir, avec justesse et authenticité, la douceur des commencements.
On connaît bien Jean-François Duval, grand reporter pour M Magazine (ses interviews de Nathalie Baye ou de Michel Houellebecq, par exemple, sont des morceaux d’anthologie…), spécialiste de Charles Bukowski et de la beat generation, mais aussi romancier de talent (Boston Blues, Phébus, 2000). Il se penche aujourd’hui sur ses années d’adolescence, dans un roman qui cherche à ressaisir, avec justesse et authenticité, la douceur des commencements.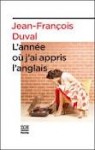 1968 : personne n’a fait mieux depuis ! Comme le note si justement Duval : « Je n’avais pu monnayer mon âme au diable qu’une seule et bonne fois. Je n’ai vécu qu’une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j’avais un temps limité devant moi. » Cet état de grâce, c’est le séjour qu’entreprend Chris, 18 ans (et donc un peu plus jeune que l’auteur…) à Cambridge, en Angleterre. Séjour linguistique (c’est le prétexte). Mais bien plus que cela en réalité. L’anglais, à cette époque (mais cela a-t-il vraiment changé ?) était la langue de la musique et de la vie, de la pensée et de l’amour. C’était la langue qui inventait le monde, créait un lien magique entre les sexes et les nationalités, incarnait le désir partagé par toute une génération.
1968 : personne n’a fait mieux depuis ! Comme le note si justement Duval : « Je n’avais pu monnayer mon âme au diable qu’une seule et bonne fois. Je n’ai vécu qu’une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j’avais un temps limité devant moi. » Cet état de grâce, c’est le séjour qu’entreprend Chris, 18 ans (et donc un peu plus jeune que l’auteur…) à Cambridge, en Angleterre. Séjour linguistique (c’est le prétexte). Mais bien plus que cela en réalité. L’anglais, à cette époque (mais cela a-t-il vraiment changé ?) était la langue de la musique et de la vie, de la pensée et de l’amour. C’était la langue qui inventait le monde, créait un lien magique entre les sexes et les nationalités, incarnait le désir partagé par toute une génération.