 Impayables, les socialistes genevois! Alors que le monde traverse une crise (financière, mais aussi politique et sociale) sans précédent, alors que Genève a besoin de personalités fortes et compétentes, ils choisissent, une fois de plus, le compromis, la pseudo-parité, l'éloge du juste de milieu. « Soyons médiocres ! » semble être leur mot d'ordre. Pourtant, samedi, lors de la désignation du ticket socialiste pour le futur Conseil d'État, les membres du PS avaient le choix. Quatre candidats pour un poste : Mmes Rielle-Fehlmann, Torracinta-Emery et Pürro et M. Tornare. Sur le papier, déjà, la lutte était inégale. Tout s'est avéré joué d'avance. L'intrigue, les complots souterrains, l'alliance des pleutres et des vélléitaires, la mesquinerie, les revanchards ont fait le reste. Le choix final s'est porté sur deux noms, qui ne font la paire que sur les photos. Charles Beer, donc, malgré un bilan désastreux (qui va s'alourdir encore dans les mois qui viennent) et Véronique Pürro, déjà éjectée une fois des joutes électorales, sont les deux dindons de la farce.
Impayables, les socialistes genevois! Alors que le monde traverse une crise (financière, mais aussi politique et sociale) sans précédent, alors que Genève a besoin de personalités fortes et compétentes, ils choisissent, une fois de plus, le compromis, la pseudo-parité, l'éloge du juste de milieu. « Soyons médiocres ! » semble être leur mot d'ordre. Pourtant, samedi, lors de la désignation du ticket socialiste pour le futur Conseil d'État, les membres du PS avaient le choix. Quatre candidats pour un poste : Mmes Rielle-Fehlmann, Torracinta-Emery et Pürro et M. Tornare. Sur le papier, déjà, la lutte était inégale. Tout s'est avéré joué d'avance. L'intrigue, les complots souterrains, l'alliance des pleutres et des vélléitaires, la mesquinerie, les revanchards ont fait le reste. Le choix final s'est porté sur deux noms, qui ne font la paire que sur les photos. Charles Beer, donc, malgré un bilan désastreux (qui va s'alourdir encore dans les mois qui viennent) et Véronique Pürro, déjà éjectée une fois des joutes électorales, sont les deux dindons de la farce.
Plus Politiquement Correct, tu meurs, dirait ma fille !
Alors que Genève a besoin, comme jamais, de fortes têtes et de compétences marquées (pour faire oublier, si c'est possible, le désastre Moutinot), le PS choisit un couple jeune et branché, polo rayé et top fuchsia, digne de la Star'Ac, en espérant que les électeurs genevois (pas plus bêtes que les autres, au demeurant) cautionneront ce choix démagogique et dangereux. Pourquoi démagogique? Parce que la « parité » n'a de valeur que si elle met sur un même pied d'égalité deux personalités aux compétences égales et reconnues par tous. Ce qui n'est pas le cas ici. Pour s'attacher le vote des femmes, le PS s'est montré prêt à tout : même à choisir Véronique Purro. Et pourquoi dangereux? Parce que, dans ce pocker menteur, les électeurs ne sont pas dupes. En voyant, une fois de plus, l'extrême légéreté (pour ne pas dire inconsistance) du ticket socialiste, ils vont se tourner vers d'autres partis, plus à même, selon eux, de fournir des réponses fortes et intelligentes à la crise. Autrement dit, les deux candidats socialistes risquent bien de rester sur la touche cet automne.
Quel gâchis, quand on pense aux qualités de Manuel Tornare ou de Laurence Rielle-Fehlmann…
 Une étrange affaire agite actuellement le landerneau romand (voir
Une étrange affaire agite actuellement le landerneau romand (voir  Quant au livre de Jacques Pilet, paru chez Favre en 1977, il s’intitulait Le crime nazi de Payerne, 1942 en Suisse, un Juif tué pour l’exemple. Je vous laisse juge des coïncidences…
Quant au livre de Jacques Pilet, paru chez Favre en 1977, il s’intitulait Le crime nazi de Payerne, 1942 en Suisse, un Juif tué pour l’exemple. Je vous laisse juge des coïncidences… Quand on pose la question à Chessex, voici ce qu’il répond : « Il s’agit d’un travail sérieux, mais qui manque cruellement de détails. Les noms des assassins ne sont pas cités et le déroulement du drame n’est pas précis. À aucun moment du livre, ni du Temps présent de l’époque d’ailleurs, on ne comprend que ce crime dépasse Payerne et qu’il s’agit vraiment du début d’Auschwitz. »
Quand on pose la question à Chessex, voici ce qu’il répond : « Il s’agit d’un travail sérieux, mais qui manque cruellement de détails. Les noms des assassins ne sont pas cités et le déroulement du drame n’est pas précis. À aucun moment du livre, ni du Temps présent de l’époque d’ailleurs, on ne comprend que ce crime dépasse Payerne et qu’il s’agit vraiment du début d’Auschwitz. »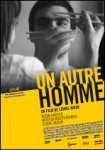 Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film.
Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film. Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).
Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).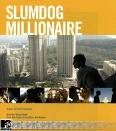 e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…
e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…