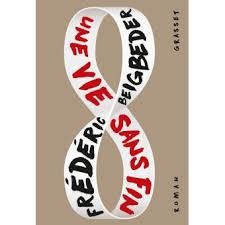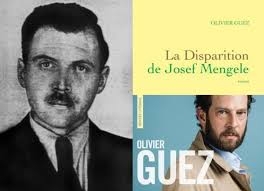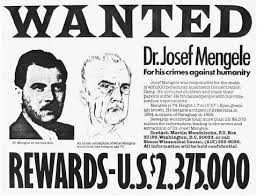La haine est mauvaise conseillère : elle aveugle et rend sourd à la recherche de la vérité, ou, tout au moins, d'une vérité qui éclairerait ou bouleverserait l'écriture. C'est ce que que l'on se dit en lisant les premières pages du récit autobiographique de Clémentine Autain, Dites-lui que je l'aime*. On se dit également qu'il s'agit d'un nouveau règlement de comptes (un genre en vogue ces temps-ci) entre une mère disparue et sa fille pleine d'amertume et de ressentiment.
La haine est mauvaise conseillère : elle aveugle et rend sourd à la recherche de la vérité, ou, tout au moins, d'une vérité qui éclairerait ou bouleverserait l'écriture. C'est ce que que l'on se dit en lisant les premières pages du récit autobiographique de Clémentine Autain, Dites-lui que je l'aime*. On se dit également qu'il s'agit d'un nouveau règlement de comptes (un genre en vogue ces temps-ci) entre une mère disparue et sa fille pleine d'amertume et de ressentiment.
Il faut dire que la fille en question n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Clémentine Autain, militante féministe, politicienne engagée aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est illustrée aussi par quelques déclarations tapageuses et clivantes sur les attentats terroristes en France. Dans son livre, Clémentine Autain montre un autre visage, plus authentique, plus touchant aussi (elle à qui l'on reproche d'être toujours glaçante!) : celui d'une fille abandonnée par une mère artiste qui préférait sa carrière professionnelle à sa vie familiale…
Comme on sait, Clémentine Autain est la fille du chanteur Yvan Dautain (à droite sur la photo) et de la comédienne Dominique Laffin, morte à 33 ans, dans des circonstances étranges (on la retrouva inanimée dans son bain : suicide ? crise cardiaque ?).  Son père l'a recueillie, enfant, alors que sa mère, étoile filante du cinéma français, enchaînait les rôles et négligeait sa fille au point d'oublier d'aller la chercher à l'école. Cette hérédité lourde à porter, on la sent à chaque page de Dites-lui que je l'aime qui, de règlement de compte familial, se transforme, au fil du récit, en déclaration d'amour.
Son père l'a recueillie, enfant, alors que sa mère, étoile filante du cinéma français, enchaînait les rôles et négligeait sa fille au point d'oublier d'aller la chercher à l'école. Cette hérédité lourde à porter, on la sent à chaque page de Dites-lui que je l'aime qui, de règlement de compte familial, se transforme, au fil du récit, en déclaration d'amour.
Car le livre, bien vite, prend la forme d'une manière d'exorcisme : comme si l'auteur devait tuer sa mère encore une fois avant de pouvoir lui parler, et comprendre qui elle fut (Clémentine avait douze ans quand sa mère est morte). Cette enfance chahutée par de nombreux déménagements, les innombrables amants de sa mère, son image idéale auprès des réalisateurs de cinéma (Claude Miller, Jacques Doillon, entre autres) et son incapacité à occuper sa place dans la « vraie vie »: tout cela crée un mur, infranchissable, entre la mère et la fille.
Il faut du temps, et beaucoup de mots pour l'escalader — ou peut-être seulement le contourner (l'enfance est le plus grand malentendu).
 Dominique Laffin était une comédienne qui a fasciné les réalisateurs français : elle avait cette lumière, cette fraîcheur, cette ingénuité que le cinéma recherche. Pendant dix ans, elle a enchaîné les premiers rôles, elle qui n'avait jamais fait d'école de théâtre (elle était baby-sitter chez Miou-Miou et Julien Clerc). Puis, les contrats sont devenus plus rares, elle a commencé à frôler les ténèbres (comme disait Duras, l'alcool a joué dans sa vie le rôle de Dieu) et entamé une descente aux enfers que personne n'a pu arrêter…
Dominique Laffin était une comédienne qui a fasciné les réalisateurs français : elle avait cette lumière, cette fraîcheur, cette ingénuité que le cinéma recherche. Pendant dix ans, elle a enchaîné les premiers rôles, elle qui n'avait jamais fait d'école de théâtre (elle était baby-sitter chez Miou-Miou et Julien Clerc). Puis, les contrats sont devenus plus rares, elle a commencé à frôler les ténèbres (comme disait Duras, l'alcool a joué dans sa vie le rôle de Dieu) et entamé une descente aux enfers que personne n'a pu arrêter…
 Tout cela, Clémentine Autain résiste à le savoir. La première partie de son livre insiste plutôt sur les raisons qu'elle a de détester sa mère — et ses raisons sont nombreuses. Puis, les résistances tombent. Elle commence son enquête sur cette femme, sa mère, cette inconnue. Elle va interroger les hommes qui l'ont aimée. Elle découvre alors une autre femme que celle qu'elle croyait connaître. Une femme rayonnante. Une femme qui pleure aussi. Une féministe engagée qui participe, avec Delphine Seyrig et d'autres comédiennes, à plusieurs manifestations. En même temps que sa plume s'adoucit, elle trace peu à peu le portrait d'une mère qu'elle peut aimer. Qu'elle peut s'autoriser à aimer.
Tout cela, Clémentine Autain résiste à le savoir. La première partie de son livre insiste plutôt sur les raisons qu'elle a de détester sa mère — et ses raisons sont nombreuses. Puis, les résistances tombent. Elle commence son enquête sur cette femme, sa mère, cette inconnue. Elle va interroger les hommes qui l'ont aimée. Elle découvre alors une autre femme que celle qu'elle croyait connaître. Une femme rayonnante. Une femme qui pleure aussi. Une féministe engagée qui participe, avec Delphine Seyrig et d'autres comédiennes, à plusieurs manifestations. En même temps que sa plume s'adoucit, elle trace peu à peu le portrait d'une mère qu'elle peut aimer. Qu'elle peut s'autoriser à aimer.
C'est la leçon de ce petit livre dense et attachant : la haine est un bouclier qui ne protège jamais de l'amour.
* Clémentine Autain, Dites-lui que je l'aime, Grasset, 2019.