par Laurence de Coulon

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

 On connaît l'état moribond de la critique littéraire en Suisse romande (et en France). La critique universitaire n'existe plus, ayant relégué ses pouvoirs et ses fonctions à la critique journalistique, de plus en plus à l'étroit, hélas, au sein de quotidiens qui — crise de la presse oblige — maigrissent de jour en jour. Pour l'Université, un bon écrivain est un écrivain mort. Les écrivains vivants se replient sur les journaux. Autrefois, ils écrivaient des livres, les publiaient, disparaissaient de la scène publique : c'était l'époque des grands poètes (Mallarmé, Baudelaire, Lautréamont) ou des avant-garde littéraires (Blanchot, Barthes, Foucauld). Aujourd'hui, ils écrivent des bouquins (ou parfois leurs nègres), les publient (ou menacent de les publier) et occupent tout le temps le devant de la scène médiatique (Angot, d'Ormesson, Amélie Nothomb, Marc Levy, etc.).
On connaît l'état moribond de la critique littéraire en Suisse romande (et en France). La critique universitaire n'existe plus, ayant relégué ses pouvoirs et ses fonctions à la critique journalistique, de plus en plus à l'étroit, hélas, au sein de quotidiens qui — crise de la presse oblige — maigrissent de jour en jour. Pour l'Université, un bon écrivain est un écrivain mort. Les écrivains vivants se replient sur les journaux. Autrefois, ils écrivaient des livres, les publiaient, disparaissaient de la scène publique : c'était l'époque des grands poètes (Mallarmé, Baudelaire, Lautréamont) ou des avant-garde littéraires (Blanchot, Barthes, Foucauld). Aujourd'hui, ils écrivent des bouquins (ou parfois leurs nègres), les publient (ou menacent de les publier) et occupent tout le temps le devant de la scène médiatique (Angot, d'Ormesson, Amélie Nothomb, Marc Levy, etc.).
Les temps, décidément, ont bien changé.
La critique littéraire n'existe plus, disais-je. Du moins en Suisse romande (qui a connu, pas si loin de nous, son âge d'Or avec des critiques comme Jean Rousset, Jean Starobinski ou Marcel Reymond). Eh bien non ! Il existe encore un critique qui sauve l'honneur de l'Université. Il s'appelle Vincent kaufmann. D'origine lausannoise, il enseigne la littérature et l'histoire des médias à l'Université de Saint-Gall.  Il est l'auteur d'une biographie incontournable de Guy Debord (La Révolution au service de la poésie, Fayard, 2001) et d'un livre passionnant sur les aventures des théories littéraires (La Faute à Mallarmé, Seuil, 2111). Aujourd'hui, Vincent Kaufmann s'attaque de manière brillante et impitoyable à la littérature entrée (malgré elle ?) dans l'ère du spectacle.
Il est l'auteur d'une biographie incontournable de Guy Debord (La Révolution au service de la poésie, Fayard, 2001) et d'un livre passionnant sur les aventures des théories littéraires (La Faute à Mallarmé, Seuil, 2111). Aujourd'hui, Vincent Kaufmann s'attaque de manière brillante et impitoyable à la littérature entrée (malgré elle ?) dans l'ère du spectacle.
Certes, cela n'est pas nouveau. Les Salons littéraires existent depuis le début du XVIIe siècle (le célèbre Salon de Catherine de Rambouillet). Il s'agissait alors de petits cercles mondains, regroupant, autour d'une hôtesse lettrée, quelques esprits remarquables. Rien à voir, me direz-vous, avec les Salons du livre d'aujourd'hui, grandes foires commerciales où l'on vend tout et n'importe quoi (« Vous aimez le vélo ? Vous allez adorer mon livre ! »), où l'écrivain, sortant pour une fois de sa tanière ou de sa grotte (voir JMO, ici), vient se mettre en représentation parmi d'autres collègues et chercher à se vendre.
Toute l'analyse de Kaufmann, grand lecteur devant l'Eternel, repose sur les intuitions développées par Guy Debord (dans La Société de spectacle, édition Quarto), mais aussi de Marshall McLuhan (« The medium is the message ») et de Régis Debray (Vie et mort de l'image, Folio).  Pour aller vite, Debray divise l'histoire des médias en trois époques distinctes : la logosphère (époque de la parole vive, l'écriture restant l'apanage d'une caste de scribes triés sur le volet) s'étendrait des origines au XVe siècle, date de l'invention de l'imprimerie ; puis, la graphosphère, née du génie de Gutenberg, qui établit pour la première fois la notion et l'autorité de l'auteur (l'auteur signe ses livres et est maître chez lui : le livre est le fruit de sa pensée individuelle); et enfin, la videosphère, époque commençant avec les débuts de la télévision et qui marque l'entrée de l'écrivain dans l'ère du spectacle. Désormais — Debray ne l'avait peut-être pas prévu — nous sommes entrés dans l'âge numérique : l'écran a remplacé l'écrit (le livre), les journaux se lisent on line, et les réseaux sociaux sont en passe de mettre tout le monde d'accord en assassinant à la fois la presse (le journal papier est bientôt obsolète) et la télévision (qu'on ne regarde plus en live, mais en replay ou en podcast).
Pour aller vite, Debray divise l'histoire des médias en trois époques distinctes : la logosphère (époque de la parole vive, l'écriture restant l'apanage d'une caste de scribes triés sur le volet) s'étendrait des origines au XVe siècle, date de l'invention de l'imprimerie ; puis, la graphosphère, née du génie de Gutenberg, qui établit pour la première fois la notion et l'autorité de l'auteur (l'auteur signe ses livres et est maître chez lui : le livre est le fruit de sa pensée individuelle); et enfin, la videosphère, époque commençant avec les débuts de la télévision et qui marque l'entrée de l'écrivain dans l'ère du spectacle. Désormais — Debray ne l'avait peut-être pas prévu — nous sommes entrés dans l'âge numérique : l'écran a remplacé l'écrit (le livre), les journaux se lisent on line, et les réseaux sociaux sont en passe de mettre tout le monde d'accord en assassinant à la fois la presse (le journal papier est bientôt obsolète) et la télévision (qu'on ne regarde plus en live, mais en replay ou en podcast).
Et la littérature dans tout ça ?
Elle est entrée, bon gré mal gré, dans le spectacle. Pour un écrivain, désormais, il ne s'agit moins d'être lu que d'être vu. Et ceux qui refusent de jouer le jeu (comme autrefois des écrivains tels que Maurice Blanchot, Pierre Bourdieu ou Michel Foucauld) sont irrémédiablement exclus du système spectaculaire. Et ceux qui se prêtent au jeu (être vu, participer à des talk-shows ou des émissions de télé-réalité) doivent obligatoirement obéir aux règles du spectacle (car tout spectacle a ses règles).
Lesquelles ?
Vincent Kaufmann en énumère quatre principales.
 1) désormais, l'écrivain ne vient plus seulement parler de ses livres à la télé, il vient comparaître devant un jury (souvent composé de collègues) : c'est l'exemple de l'émission On n'est pas couché, dans laquelle l'écrivain (mais aussi le cinéaste, le chanteur, etc.) passe devant les procureurs Christine Angot et Yann Moix.
1) désormais, l'écrivain ne vient plus seulement parler de ses livres à la télé, il vient comparaître devant un jury (souvent composé de collègues) : c'est l'exemple de l'émission On n'est pas couché, dans laquelle l'écrivain (mais aussi le cinéaste, le chanteur, etc.) passe devant les procureurs Christine Angot et Yann Moix.
2) Un bon écrivain du spectacle, comparaissant devant le tribunal populaire, doit maîtriser la culture de l'aveu : son livre doit livrer en pâture un événement tragique de sa propre existence (sous couvert d'autofiction). Les plus beaux exemples, analysés par Kaufmann, sont ici Christine Angot (et son fameux inceste), mais aussi Annie Ernaux (racontant comment son père a tenté d'assassiner sa mère ou racontant dans les moindres détails son avortement) et Serge Doubrovski (dans Le Livre brisé, il raconte la mort de sa compagne et chacun se souvient encore de la question de Bernard Pivot lors d'un Apostrophes : « C'est bien vous qui l'avez tuée, non ? »).
3) L'écrivain en représentation doit toujours se montrer authentique. Il ne doit pas mentir sur lui ou ses personnages (désormais, c'est la même chose). Il doit parler vrai, raconter sa vie, promettre de dire toute la vérité. Comme au tribunal.
4) Et bien sûr, corollaire de l'authenticité : il ne doit pas mentir. Il doit être parfaitement transparent. Pas d'effet de style. Pas de jeu sur la langue. Pas de masque ou de posture théâtrale. Le lecteur (ou plutôt le téléspectateur ne doit rien ignorer de sa vie, de ses manies, de ses vices et de ses vertus.
 Vincent Kaufmann suggère une cinquième règle, une sorte de nec plus ultra, qui rajoute un supplément de valeur au spectacle : chaque livre doit être l'objet d'un sacrifice. Annie Ernaux, par exemple, exhibe le sacrifice de son enfant (dont elle se sentira à jamais coupable) dans L'Événement. Serge Doubrovski raconte le sacrifice de sa compagne (une sacrifice réel, puisqu'elle s'est suicidée) qui donne sens à son Livre brisé.
Vincent Kaufmann suggère une cinquième règle, une sorte de nec plus ultra, qui rajoute un supplément de valeur au spectacle : chaque livre doit être l'objet d'un sacrifice. Annie Ernaux, par exemple, exhibe le sacrifice de son enfant (dont elle se sentira à jamais coupable) dans L'Événement. Serge Doubrovski raconte le sacrifice de sa compagne (une sacrifice réel, puisqu'elle s'est suicidée) qui donne sens à son Livre brisé.
Comment sortir du spectacle ? C'est une question qui me passionne depuis toujours : elle est au cœur de presque tous les livres (en particulier, L'Amour nègre, Après l'orgie et Passion noire). Vincent Kaufmann l'approfondit avec infiniment d'intelligence et d'acuité. Son livre, Dernières nouvelles du spectacle*, est un régal de lecture. Sans doute un des plus importants livres de critique (littéraire, mais aussi médiatique, philosophique, sociologique) de ces dernières années.
Qui osait dire que la critique littéraire n'existait plus ?
Certes, à Genève, à Lausanne ou à Neuchâtel, elle est moribonde. Mais à Saint-Gall, elle jouit d'une vitalité remarquable et qui fait chaud au cœur.
* Vincent Kaufmann, Dernières nouvelles du spectacle (ce que les médias font à la littérature), Le Seuil, 2017.
 Copernic ou Freud ? Héliocentrisme ou toute-puissance de l'Inconscient ? Ces deux révolutions ont modifié fondamentalement notre vision du monde. Mais qu'est-ce que le monde ? Et surtout : où est le centre, s'il y en a un ? Nicolas Copernic (1473-1543) renverse l'ordre des choses : au centre, il y a le soleil, et la Terre tourne autour.
Copernic ou Freud ? Héliocentrisme ou toute-puissance de l'Inconscient ? Ces deux révolutions ont modifié fondamentalement notre vision du monde. Mais qu'est-ce que le monde ? Et surtout : où est le centre, s'il y en a un ? Nicolas Copernic (1473-1543) renverse l'ordre des choses : au centre, il y a le soleil, et la Terre tourne autour. 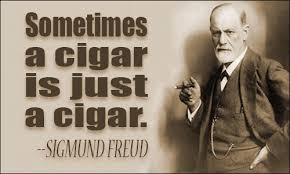 À son époque, personne n'y croit. C'est une folie ! Et pourtant il a raison. Pour Sigmund Freud (1856-1939), le psychanalyste viennois, au centre, il y a l'Inconscient, surveillé par le terrible Sur-Moi. C'est un continent perdu, que Freud compare aux Enfers, un cloaque, un cimetière remplis de morts-vivants.
À son époque, personne n'y croit. C'est une folie ! Et pourtant il a raison. Pour Sigmund Freud (1856-1939), le psychanalyste viennois, au centre, il y a l'Inconscient, surveillé par le terrible Sur-Moi. C'est un continent perdu, que Freud compare aux Enfers, un cloaque, un cimetière remplis de morts-vivants.
 Dans son dernier roman, Centre*, Philippe Sollers plonge tout de suite au cœur du tourbillon, dans l'œil du cyclone. Mais le centre ne se laisse pas aussi facilement approcher. Il faut franchir les paliers successifs de l'humaine comédie. Avoir un guide, des mots, la lumière du désir. Dante avait sa Béatrice ; le narrateur de Centre a sa Nora, 40 ans, psychanalyste, accoutumée aux plaintes et aux ruses de l'âme humaine.
Dans son dernier roman, Centre*, Philippe Sollers plonge tout de suite au cœur du tourbillon, dans l'œil du cyclone. Mais le centre ne se laisse pas aussi facilement approcher. Il faut franchir les paliers successifs de l'humaine comédie. Avoir un guide, des mots, la lumière du désir. Dante avait sa Béatrice ; le narrateur de Centre a sa Nora, 40 ans, psychanalyste, accoutumée aux plaintes et aux ruses de l'âme humaine.
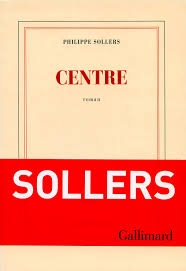 Tout le roman procède par cercles concentriques et par associations. On passe ainsi de la Bible à Shakespeare (l'énigme d'Othello, raciste, antisémite, islamophobe ?), de la révolution freudienne à Baudelaire, de Rome à Venise, puis à Naples, d'un fait divers à la Trinité chrétienne, etc. Comme toujours avec Sollers, le ton est allègre, la navigation agréable. Le narrateur, qui est un « voyageur du temps », se laisse porter par les images et les mots. Les mots surtout, qui sont le centre névralgique du livre. « Le centre vient de partout, tourne autour de lui-même. » Seuls les poètes, peut-être, nous y donnent accès. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Rimbaud, Baudelaire et un certain isidore Ducasse, dit aussi Comte de Lautréamont, traversent ces pages lumineuses et aériennes.
Tout le roman procède par cercles concentriques et par associations. On passe ainsi de la Bible à Shakespeare (l'énigme d'Othello, raciste, antisémite, islamophobe ?), de la révolution freudienne à Baudelaire, de Rome à Venise, puis à Naples, d'un fait divers à la Trinité chrétienne, etc. Comme toujours avec Sollers, le ton est allègre, la navigation agréable. Le narrateur, qui est un « voyageur du temps », se laisse porter par les images et les mots. Les mots surtout, qui sont le centre névralgique du livre. « Le centre vient de partout, tourne autour de lui-même. » Seuls les poètes, peut-être, nous y donnent accès. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Rimbaud, Baudelaire et un certain isidore Ducasse, dit aussi Comte de Lautréamont, traversent ces pages lumineuses et aériennes.
« Là où c'était, je dois advenir », écrivait le psychanalyste Jacques Lacan dans une de ces formules dont il avait le secret. « Le cercle s'élargit, le centre s'approfondit, avec, comme conséquence, une commotion intense des dates. » Si la réalité est une passion triste, « le désir est un réel joyeux ».
Comme la terre tourne autour du soleil, et le conscient autour du gouffre inconscient, le roman de Sollers se rapproche de ce point de fusion, en nous et en dehors de nous, où, par la grâce des mots, la poésie, la fulgurante des images, se déploie devant nos yeux un monde nouveau.
* Philippe Sollers, Centre, roman, Gallimard, 2018.