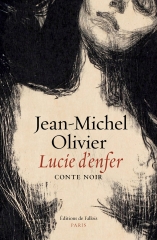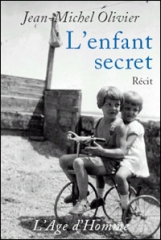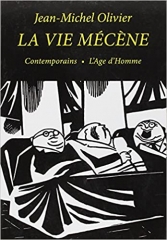Il y a dix ans, jour pour jour, le 28 juin 2011, je recevais un coup de téléphone de la gendarmerie française. Est-ce que je connaissais un certain Vladimir Dimitrijevic ? Bien sûr. C'était mon éditeur et mon ami. Pourquoi ? Il vient d'avoir un accident avec sa camionnette. Il est décédé. Votre nom figure dans les contacts de son portable. (Sur la photo, prise en 2004 lors de la remise du Prix Dentan pour L'Enfant secret, on reconnaît, à la gauche de Dimitri, Claude Frochaux, Rafik ben Salah et JMO)
Il y a dix ans, jour pour jour, le 28 juin 2011, je recevais un coup de téléphone de la gendarmerie française. Est-ce que je connaissais un certain Vladimir Dimitrijevic ? Bien sûr. C'était mon éditeur et mon ami. Pourquoi ? Il vient d'avoir un accident avec sa camionnette. Il est décédé. Votre nom figure dans les contacts de son portable. (Sur la photo, prise en 2004 lors de la remise du Prix Dentan pour L'Enfant secret, on reconnaît, à la gauche de Dimitri, Claude Frochaux, Rafik ben Salah et JMO)
Trois ans plus tard, pour rendre hommage à Dimitri et raconter l'histoire extraordinaire de sa vie, j'ai publié L'Ami barbare. Jérôme Garcin, dans L'Obs, lui a consacré l'article suivant, que je reproduis.
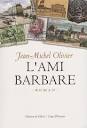 « Né yougoslave, naturalisé suisse, il est mort au volant de sa camionnette, qui était à la fois sa couchette et sa bibliothèque. Il avait successivement grandi sous Tito, milité contre le système soviétique, frayé avec l'extrême droite, embrassé le nationalisme serbe et pris fait et cause pour Milosevic. Ses deux passions étaient le football et la littérature. Il pratiqua longtemps le premier en amateur et pour honorer la seconde, fonda, au milieu des années 1960, les Editions L'Age d'Homme. Il y publia les grands livres des grands dissidents (Vie et Destin de Grossman, les Hauteurs béantes de Zinoviev), les meilleurs écrivains suisses (Amiel, Ramuz, Cingria, Haldas, Chessex), et une flopée de têtes brûlées. Il s'appelait Vladimir Dimitrijevic. On le surnommait « Dimitri ». C'était une légende, c'est toujours une énigme.
« Né yougoslave, naturalisé suisse, il est mort au volant de sa camionnette, qui était à la fois sa couchette et sa bibliothèque. Il avait successivement grandi sous Tito, milité contre le système soviétique, frayé avec l'extrême droite, embrassé le nationalisme serbe et pris fait et cause pour Milosevic. Ses deux passions étaient le football et la littérature. Il pratiqua longtemps le premier en amateur et pour honorer la seconde, fonda, au milieu des années 1960, les Editions L'Age d'Homme. Il y publia les grands livres des grands dissidents (Vie et Destin de Grossman, les Hauteurs béantes de Zinoviev), les meilleurs écrivains suisses (Amiel, Ramuz, Cingria, Haldas, Chessex), et une flopée de têtes brûlées. Il s'appelait Vladimir Dimitrijevic. On le surnommait « Dimitri ». C'était une légende, c'est toujours une énigme.
Trois ans après sa disparition, celui qui fut l'un de ses auteurs, Jean-Michel Olivier, prix Interallié 2010 pour L'Amour nègre, lui consacre un roman où tout est vrai, où tout est faux. Dimitri se nomme ici Roman Dragomir. Son cadavre bouge encore, devant lequel viennent s'incliner sept de ses amis qui, les uns après les autres, témoignent d'un moment de sa vie: l'enfance belgradoise, l'exil en Suisse via l'Italie, la naissance de sa maison d'édition, la guerre en Yougoslavie et la gloire du paria.
Chose étonnante: plus on avance dans ce livre rythmé par des histoires d'ânes, pétrifiés ou bâtés, plus la biographie de cet homme semble s'éclairer et plus son mystère ne cesse de s'épaissir.  Qui était vraiment cet éditeur célèbre installe dans «un pays de taiseux», qui ne répondait jamais au téléphone, ne payait ni ses fournisseurs ni ses auteurs, et dormait comme un SDF dans sa camionnette? Pourquoi ce fin lettré était-il si barbare et ce guerrier, si sentimental?
Qui était vraiment cet éditeur célèbre installe dans «un pays de taiseux», qui ne répondait jamais au téléphone, ne payait ni ses fournisseurs ni ses auteurs, et dormait comme un SDF dans sa camionnette? Pourquoi ce fin lettré était-il si barbare et ce guerrier, si sentimental?
Comment cet anticommuniste pouvait-il être soudain rattrapé par la nostalgie de l'empire soviétique? Quelles étaient donc les femmes de ce célibataire toujours habillé de noir? D'où lui venait cette propension à fréquenter en priorité des monarchistes, des anarchistes, des poseurs de bombes, des agents doubles, des insoumis?
Dans une prose simple, sans graisse, protestante, Jean- Michel Olivier force volontiers le trait. C'est qu'il veut faire le portrait, et il y réussit, d'un « cheval fou », d'un « tyran magnifique », d'un franc-tireur insaisissable qui aimait les alcools forts, la viande rouge, les cigarettes américaines, les icônes du Moyen Age et les microfilms glissés dans les macarons à la pistache.
 Le romancier d'Après l'orgie aurait pu intituler ce livre : Après Dimitri. Car c'est en réinventant la vie de son éditeur et ami qu'il en fait, traversant le siècle dernier, une véritable épopée, où le tragique frôle parfois le comique. « Un bon joueur, disait Vladimir Dimitrijevic, est comme Don Quichotte: il est bizarrement fait, maladroit, filiforme, mais il est un excellent footballeur. »
Le romancier d'Après l'orgie aurait pu intituler ce livre : Après Dimitri. Car c'est en réinventant la vie de son éditeur et ami qu'il en fait, traversant le siècle dernier, une véritable épopée, où le tragique frôle parfois le comique. « Un bon joueur, disait Vladimir Dimitrijevic, est comme Don Quichotte: il est bizarrement fait, maladroit, filiforme, mais il est un excellent footballeur. »
Une manière, somme toute, d'autoportrait. Celui d'un Quichotte slave, dont Jean-Michel Olivier, fidèle jusqu'au bout, serait le Sancho Pança. »
JEROME GARCIN
article paru dans L'Obs N° 2614, du 11 au 17.12.2014