
L'Italie vient de perdre l'un de ses plus grands écrivains, Antonio Tabucchi, décédé à Lisbonne, sa ville d'adoption. Je l'avais rencontré il y a plusieurs années, lors de la parution de son roman sans doute le plus connu, Pereira prétend (porté au cinéma, avec Marcello Mastroianni dans le rôle-titre). C'était un homme d'une grande douceur, d'une intelligence aiguë et d'une ironie mordante. Voici l'entretien qu'il m'a accordé.
Dans « Pereira prétend »*, Antonio Tabucchi met en scène un personnage étrange qui raconte, avec une minutie jalouse, un moment tragique de son existence et de l'histoire européenne : le fatidique mois d'août 1938. Sur fond de salazarisme portugais, de fascisme italien et de guerre espagnole, on découvre l'histoire de la prise de conscience d'un vieux journaliste solitaire, témoin plus qu'acteur de l'Histoire. Paru l'année dernière en Italie, « Pereira prétend » a reçu un accueil enthousiaste, tant de la presse que du public, et vient d'être adapté au cinéma dans un film où l'on retrouve face à face Marcello Mastroianni et Daniel Auteuil.
— Avant d'enseigner à l'Université de Sienne, vous avez suivi des cours à l'École des Hautes Études de Paris. Quelles sont vos affinités avec la pensée françaises ?
— Quand j'étais jeune étudiant à l'Université, j'ai décidé de passer un an à Paris. C'était le début des années soixante. L'Italie, en ce temps-là, était un peu provinciale et l'on n'y n'enseignait que les classiques : Goldoni, Manzoni… Mon séjour parisien m'a permis d'élargir considérablement mon horizon : c'est là que j'ai connu Diderot, Flaubert, Mallarmé, et que j'ai connu le cinéma, le théâtre…
— On a l'impression que votre œuvre a d'abord été reconnue en France, puis seulement en Italie. Est-ce vrai ?
— Vous savez, en Italie, on se méfie beaucoup des écrivains qui s'intéressent au monde — et pas seulement à l'Italie ! La connaissance que j'ai reçue de la France est un peu retombée sir l'Italie. C'est à ce moment-là que mes compatriotes se sont dit : “Finalement, si Tabucchi est apprécié en France, il doit être intéressant.”
— La France, comme on sait, est un pays entièrement centralisé, et ne reconnaît que ce qui vient de Paris. Est-ce la même chose en Italie ?
— Non, l'Italie, c'est la dispersion. Naples ne vaut pas plus que Milan, ou Florence, ou Turin, ou Venise, ou Rome. C'est d'ailleurs pourquoi les écrivains italiens ne parviennent pas à constituer un groupe. Cela serait très facile si on vivait dans un pays comme la France, où toute l'intellectualité vit à Paris: Mais pour nous c'est très difficile d'avoir des contacts avec les autres écrivains. Je vis à Florence, un grand ami à moi vit à Venise, un autre à Rome… L'Italie demeure un pays extrêmement régionaliste.
— Est-ce que Nocturne indien, le film qu'Alain Corneau a tiré de votre magnifique roman, vous a emmené de nouveaux lecteurs ?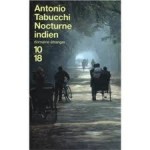
— Oui, mais en France, plus qu'en Italie ! La raison en est simple : en Italie, le cinéma américain jouit d'une suprématie presque absolue. Les films européens — et surtout français — ont beaucoup de peine à toucher un large public. C'est très dommage. Quant au film de Corneau, il a été projeté dans le circuit des ciné-clubs. Il a connu un important succès critique, mais est resté ignoré par le grand public. C'est le problème d'un pays comme l'Italie qui regarde constamment vers l'Amérique, en essayant de lui ressembler, en copiant ses désirs, ses habitudes, sa culture.
— Quelle est la position des intellectuels italiens, et des écrivains en particulier, devant l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Berlusconi ?
— Je crois que les écrivains italiens n'apprécient pas beaucoup Berlusconi, mais très peu le disent. Devant cette manifestation d'arrogance, qu'on subit tous les jours à la télévision ou ailleurs, je trouve les intellectuels très timides. En revanche, l'Italie peut compter sur un journalisme très combattif, qui s'oppose à cette omnipotence de la nouvelle droite — qui d'ailleurs ressemble étrangement à l'ancienne.
— Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain cosmopolite ?
 — En tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, je pense que j'appartiens au monde. Je pense aussi qu'un banquier de Genève ou un pêcheur de l'Inde sont animés par les mêmes sentiments : l'amour, la joie, la tristesse, le désir… J'écris sur des choses universelles et je me suis toujours refusé à faire la chronique de l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ses manifestations, toutes ses manifestations, et je peux rencontrer n'importe où un personnage qui fascine, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans mon village ou à Genève.
— En tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, je pense que j'appartiens au monde. Je pense aussi qu'un banquier de Genève ou un pêcheur de l'Inde sont animés par les mêmes sentiments : l'amour, la joie, la tristesse, le désir… J'écris sur des choses universelles et je me suis toujours refusé à faire la chronique de l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ses manifestations, toutes ses manifestations, et je peux rencontrer n'importe où un personnage qui fascine, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans mon village ou à Genève.
— Chez Pessoa, est-ce ce côté universel de la conscience qui vous attire ?
— Oui. Pessoa a réussi à créer un univers romanesque au moment où les romans, en Europe, traversaient une crise profonde. Avec la poésie, il a créé un espace tout à la fois théâtral et romanesque, qui met en scène des personnages jouant leur vie. Donc il a reconstruit, avec une pirouette, le romanesque au XXème siècle, comme Kafka ou Joyce l'avaient fait avant lui.
Propos recueillis par Jean-Michel OLIVIER
L'œuvre d'Antonio Tabucchi est publiée aux Editions Bourgois et Gallimard, de L'Ange noi aux Rêves de rêves, en passant par Le Fil de l'horizon, Petits malentendus sans importance et, bien entendu, Nocturne indien.
* Pereira prétend a été traduit par Bernard Comment.
 À qui profite le crime ? Au criminel qui a volé, tué ou violé ? À la victime qui a fait la preuve de son innocence ? À la Justice qui tranche entre le Bien et le Mal ?
À qui profite le crime ? Au criminel qui a volé, tué ou violé ? À la victime qui a fait la preuve de son innocence ? À la Justice qui tranche entre le Bien et le Mal ? En publiant des documents volés, des extraits d'interrogatoire couverts par le secret de l'instruction, des confidences et des ragots insensés. Jamais la presse n'est tombée aussi bas. Voyeurisme. Populisme. Jamais elle n'a fait preuve d'un tel acharnement. Pourquoi ? Pour défendre les pauvres escorts malmenées par DSK ? Si seulement ! Par nostalgie puritaine ? Non plus. Pour écarter définitivement un homme politique du pouvoir ? Peut-être bien. Mais alors pourquoi ? Pour une raison toute simple : à l'époque où la presse tire la langue, où les journaux voient leur audience diminuer chaque jour, l'affaire DSK est du pain béni. Une aubaine ! Elle fait grimper les ventes, aussi sûrement que le Viagra aide à redresser certaines situations défaillantes. Le seul intérêt des articles minables qui retracent cette affaire, c'est d'augmenter le tirage des journaux, de prendre les lecteurs non par les sentiments, mais par les couilles (ou ailleurs, si l'on veut). Et une fois qu'on les tient, on ne les lâche plus…
En publiant des documents volés, des extraits d'interrogatoire couverts par le secret de l'instruction, des confidences et des ragots insensés. Jamais la presse n'est tombée aussi bas. Voyeurisme. Populisme. Jamais elle n'a fait preuve d'un tel acharnement. Pourquoi ? Pour défendre les pauvres escorts malmenées par DSK ? Si seulement ! Par nostalgie puritaine ? Non plus. Pour écarter définitivement un homme politique du pouvoir ? Peut-être bien. Mais alors pourquoi ? Pour une raison toute simple : à l'époque où la presse tire la langue, où les journaux voient leur audience diminuer chaque jour, l'affaire DSK est du pain béni. Une aubaine ! Elle fait grimper les ventes, aussi sûrement que le Viagra aide à redresser certaines situations défaillantes. Le seul intérêt des articles minables qui retracent cette affaire, c'est d'augmenter le tirage des journaux, de prendre les lecteurs non par les sentiments, mais par les couilles (ou ailleurs, si l'on veut). Et une fois qu'on les tient, on ne les lâche plus…
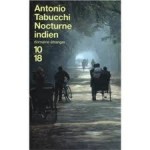
 — En tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, je pense que j'appartiens au monde. Je pense aussi qu'un banquier de Genève ou un pêcheur de l'Inde sont animés par les mêmes sentiments : l'amour, la joie, la tristesse, le désir… J'écris sur des choses universelles et je me suis toujours refusé à faire la chronique de l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ses manifestations, toutes ses manifestations, et je peux rencontrer n'importe où un personnage qui fascine, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans mon village ou à Genève.
— En tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, je pense que j'appartiens au monde. Je pense aussi qu'un banquier de Genève ou un pêcheur de l'Inde sont animés par les mêmes sentiments : l'amour, la joie, la tristesse, le désir… J'écris sur des choses universelles et je me suis toujours refusé à faire la chronique de l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ses manifestations, toutes ses manifestations, et je peux rencontrer n'importe où un personnage qui fascine, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans mon village ou à Genève. Je viens de passer une semaine à New York dans le cadre d’une délégation genevoise (à laquelle s’est joint, pour quelques jours, the former President of the Swiss Confederation,
Je viens de passer une semaine à New York dans le cadre d’une délégation genevoise (à laquelle s’est joint, pour quelques jours, the former President of the Swiss Confederation, Un autre débat, passionnant, a tourné autour de l’éducation. Les idées défendues par Rousseau dans son Émile
Un autre débat, passionnant, a tourné autour de l’éducation. Les idées défendues par Rousseau dans son Émile