 Cet entretien inédit de Jean-François Duval avec Jean Baudrillard a paru dans Une Semaine Avant l’Élection, Journal Ephémère. Il date de 1983, mais il n'a pas pris une ride. Il vaut la peine de réfléchir, aujourd'hui plus encore qu'hier, à la place de l'argent dans nos vies, à sa valeur et à son rôle.
Cet entretien inédit de Jean-François Duval avec Jean Baudrillard a paru dans Une Semaine Avant l’Élection, Journal Ephémère. Il date de 1983, mais il n'a pas pris une ride. Il vaut la peine de réfléchir, aujourd'hui plus encore qu'hier, à la place de l'argent dans nos vies, à sa valeur et à son rôle.
— Jean-François Duval: Jean Baudrillard, comment parler d'argent, aujourd'hui?
— Jean Baudrillard: Aujourd'hui, l'argent, ou la monnaie, devient une espèce d'objet qui n'a plus de prix, quelque chose qui est hors valeur, qui surplombe les économies mondiales, qui les règle ou les dérègle selon une espèce d'arbitraire. Et qui est source d'une fascination éblouie du fait de sa possibilité d'exister en dehors de tout sujet. Et de tout échange particulier. Car au fond, qui contrôle ça, maintenant? C'est un ordre de domination, mais flottant. Il n'y a plus un sujet de la domination. Non, il y a l'argent, qui a été mis sur orbite et qui ne varie plus en fonction des productions. Il a son cycle de circulation, il se lève, il se couche comme un soleil.
Ce n'est plus de l'argent d'ailleurs. Il y a un malentendu à parler de cela en terme d'argent. C'est une puissance. Et une puissance qui semble avoir échappé à tout le monde. La dissuasion me paraît être la dimension fondamentale de cet univers-là. Elle permet qu'il n'y ait plus nulle part de territoire, qu'il n'y ait plus rien d'appropriable. Ni même, comme je l'ai dit, de sujets. Il y a là une façon de prendre en otage le reste du monde. Et cette chose-là, on ne peut plus la rapatrier. C'est comme un engin spatial qu'on a lancé... il tourne, il tourne... On satellise des puissances monétaires comme on met sur orbite des bombes nucléaires, et elles en viennent à exercer un semblable pouvoir de dissuasion. N'étant plus des sujets, nous sommes nous-mêmes mis en orbite par ces puissances-là. — Jean-François Duval: L'argent supposait une scène de l'échange qui a disparu?
— Jean-François Duval: L'argent supposait une scène de l'échange qui a disparu?
— Jean Baudrillard: Oui, l'argent — et c'est pourquoi ce terme est dépassé —, c'était quelque chose qui était en représentation, qui supposait encore des acteurs. Avec lui, c'est toute une dramaturgie qui disparaît. Un jour, on se rendra peut-être compte que c'était encore un univers vivant. Au lieu de quoi on aura obtenu un univers où il n'y a plus un sujet et un Autre, ni même donc d'aliénation possible. Un univers où les sujets sont complètement ventilés. Désormais, l'argent, qui a été pendant longtemps le signe d'une circulation accélérée par rapport au troc et aux objets, j'ai l'impression qu'il est dépassé comme système d'échange. Plus vraiment opérationnel. Il est en trop.  Le transit se fait par des choses encore plus abstraites. Dans un système de communication plus avancé, on peut supposer qu'il serait tout à fait volatilisé. L'argent est devenu trop réaliste, il reste trop figuratif. Et on n'est plus dans le figuratif. On est dans un univers beaucoup plus aléatoire, où les choses n'appartiennent plus à personne. L'argent, aujourd'hui, c'est presque comme un cadavre dont on se demande comment s'en débarrasser.
Le transit se fait par des choses encore plus abstraites. Dans un système de communication plus avancé, on peut supposer qu'il serait tout à fait volatilisé. L'argent est devenu trop réaliste, il reste trop figuratif. Et on n'est plus dans le figuratif. On est dans un univers beaucoup plus aléatoire, où les choses n'appartiennent plus à personne. L'argent, aujourd'hui, c'est presque comme un cadavre dont on se demande comment s'en débarrasser.
— Jean-François Duval: On n'est plus dans la comédie balzacienne ni dans les vieux romans policiers, quand il existait encore un temps de l'accumulation et de la dépense, une théâtralité dans la manière dont les gens par exemple claquaient du fric... — Jean Baudrillard: Oh oui, les grands flambeurs, c'est vrai qu'on n'en voit plus tellement. L'avare, c'est aussi un personnage qui commence à devenir impensable. Un jour, on se demandera ce que ce mot veut dire. On peut faire le parallèle avec le cinéma, qui a évolué d'une grande scène, avec des idoles, des stars, à une gestion beaucoup plus banale. Les choses ne se théâtralisent plus, elles se banalisent. Pour dépenser, il faut un excédent, du luxe, une somptuosité, une culture de prestige qui joue sur des différences fortes. Alors, certes, les différences sont encore très grandes, mais elles ne jouent plus : on évolue vers un système purement opérationnel. Jadis, l'argent était riche d'histoires, de mythologies, de récits, de romans. À la Belle Époque, par exemple, l'argent était roi. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore un roi qui traînait quelque part. Il y avait une représentation des choses, même si elle était mystifiante, aliénante. Avec les nouveaux prolongements électroniques, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a rien à raconter. On n'inventera là-dessus ni une autre scène, ni une autre théâtralité, ni un autre romanesque. Tout ce qui restera, c'est une espèce de fascination collective. C'est comme dans la mode, où le cérémonial s'est perdu, où on ne déploie plus tout un faste. Elle n'a rien perdu de son intensité, mais le relief s'est aplani. Elle se borne à fonctionner. C'est encore un signe de l'universalisation de ce type de phénomènes.
— Jean Baudrillard: Oh oui, les grands flambeurs, c'est vrai qu'on n'en voit plus tellement. L'avare, c'est aussi un personnage qui commence à devenir impensable. Un jour, on se demandera ce que ce mot veut dire. On peut faire le parallèle avec le cinéma, qui a évolué d'une grande scène, avec des idoles, des stars, à une gestion beaucoup plus banale. Les choses ne se théâtralisent plus, elles se banalisent. Pour dépenser, il faut un excédent, du luxe, une somptuosité, une culture de prestige qui joue sur des différences fortes. Alors, certes, les différences sont encore très grandes, mais elles ne jouent plus : on évolue vers un système purement opérationnel. Jadis, l'argent était riche d'histoires, de mythologies, de récits, de romans. À la Belle Époque, par exemple, l'argent était roi. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore un roi qui traînait quelque part. Il y avait une représentation des choses, même si elle était mystifiante, aliénante. Avec les nouveaux prolongements électroniques, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a rien à raconter. On n'inventera là-dessus ni une autre scène, ni une autre théâtralité, ni un autre romanesque. Tout ce qui restera, c'est une espèce de fascination collective. C'est comme dans la mode, où le cérémonial s'est perdu, où on ne déploie plus tout un faste. Elle n'a rien perdu de son intensité, mais le relief s'est aplani. Elle se borne à fonctionner. C'est encore un signe de l'universalisation de ce type de phénomènes.
En peinture aussi, on n'a plus affaire à des œuvres qui ont une valeur. Un jugement devient de plus en plus difficile. L'art ne tient plus dans un théâtre ni une scène où les images avaient une puissance de représentation. Quand je dis "scène", ce n'est pas simplement de la scène théâtrale que je parle, mais aussi de la scène du social, de la scène historique, de la scène du sujet. Tout était scène. Mais cette scène s'est volatilisée. Et, avec elle, le regard, au sens noble du terme — je veux dire le regard comme vision, comme jugement.
Ce que je décris ici, bien sûr, c'est une tendance à la limite. Mais c'est bien vers ça que nous nous dirigeons. L'argent, je crois, n'a jamais eu plus de sens et de signification qu'à l'ère de la marchandise telle que la dépeint Marx, avec ses cycles d'épargne et d'accumulation primitive. Aujourd'hui, tout cela semble bien archaïque. Quoi qu'on nous dise, l'ère n'est plus à l'épargne, à la thésaurisation, elle est à l'anticipation. L'argent est un gigantesque modèle de simulation de la valeur, encore trop réaliste.
 On connaît bien Jean-François Duval, grand reporter pour M Magazine, spécialiste de Charles Bukowski et de la beat generation, mais aussi romancier de talent (Boston Blues, Phébus, 2000). Il se penche aujourd’hui sur ses années d’adolescence, dans un roman qui cherche à ressaisir, avec justesse et authenticité, la douceur des commencements.
On connaît bien Jean-François Duval, grand reporter pour M Magazine, spécialiste de Charles Bukowski et de la beat generation, mais aussi romancier de talent (Boston Blues, Phébus, 2000). Il se penche aujourd’hui sur ses années d’adolescence, dans un roman qui cherche à ressaisir, avec justesse et authenticité, la douceur des commencements. 1968 : personne n’a fait mieux depuis ! Comme le note si justement Duval : « Je n’avais pu monnayer mon âme au diable qu’une seule et bonne fois. Je n’ai vécu qu’une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j’avais un temps limité devant moi. » Cet état de grâce, c’est le séjour qu’entreprend Chris, 18 ans (et donc un peu plus jeune que l’auteur…) à Cambridge, en Angleterre. Séjour linguistique (c’est le prétexte). Mais bien plus que cela en réalité. L’anglais, à cette époque (mais cela a-t-il vraiment changé ?) était la langue de la musique et de la vie, de la pensée et de l’amour. C’était la langue qui inventait le monde, créait un lien magique entre les sexes et les nationalités, incarnait le désir partagé par toute une génération.
1968 : personne n’a fait mieux depuis ! Comme le note si justement Duval : « Je n’avais pu monnayer mon âme au diable qu’une seule et bonne fois. Je n’ai vécu qu’une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j’avais un temps limité devant moi. » Cet état de grâce, c’est le séjour qu’entreprend Chris, 18 ans (et donc un peu plus jeune que l’auteur…) à Cambridge, en Angleterre. Séjour linguistique (c’est le prétexte). Mais bien plus que cela en réalité. L’anglais, à cette époque (mais cela a-t-il vraiment changé ?) était la langue de la musique et de la vie, de la pensée et de l’amour. C’était la langue qui inventait le monde, créait un lien magique entre les sexes et les nationalités, incarnait le désir partagé par toute une génération.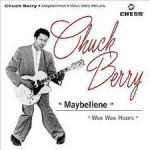 Chris rencontre Mike, qui compose avec talent des protest songs, Simon qui collectionne les voitures anciennes, Harry le doux colosse et, bien sûr, Maybelene, 17 ans, tout droit sortie d’une chanson de Chuck Berry. C’est avec elle que Chris va connaître une passion dévorante, comme une suite de métamorphoses inattendues : de nouvelles naissances.
Chris rencontre Mike, qui compose avec talent des protest songs, Simon qui collectionne les voitures anciennes, Harry le doux colosse et, bien sûr, Maybelene, 17 ans, tout droit sortie d’une chanson de Chuck Berry. C’est avec elle que Chris va connaître une passion dévorante, comme une suite de métamorphoses inattendues : de nouvelles naissances. En traitant Gérard Depardieu de « minable », le premier ministre français Jean-Marc Ayrault, relayé par sa collègue ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, n'a pas seulement commis une erreur, mais une faute. En insultant Gégé, le sinistre Ayrault ne s'en prend pas à n'importe qui : il essaie de salir le plus grand comédien français contemporain (170 films tournés, d'Audiard à Duras, de Godard à Berri, de Bertolucci à Kassovitz) en le désignant à la vindicte populaire, parce qu'il a décidé de s'installer en Belgique. Heureusement que le grand Gégé n'est pas allé se loger en Allemagne : on l'aurait traité de collabo !
En traitant Gérard Depardieu de « minable », le premier ministre français Jean-Marc Ayrault, relayé par sa collègue ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, n'a pas seulement commis une erreur, mais une faute. En insultant Gégé, le sinistre Ayrault ne s'en prend pas à n'importe qui : il essaie de salir le plus grand comédien français contemporain (170 films tournés, d'Audiard à Duras, de Godard à Berri, de Bertolucci à Kassovitz) en le désignant à la vindicte populaire, parce qu'il a décidé de s'installer en Belgique. Heureusement que le grand Gégé n'est pas allé se loger en Allemagne : on l'aurait traité de collabo !