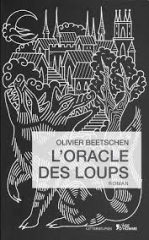Son roman précédent, Centre*, procédait par cercles concentriques, en recherchant sans cesse son point d'appui, son point de fuite ou de rupture, pour toucher l'essentiel : le cœur absolu des choses. On y croisait des visages familiers : Copernic, Freud, mais aussi Dante et Shakespeare (déjà!) et l'inoubliable Comte de Lautréamont, auteur mystérieux des Chants de Maldoror.
Son roman précédent, Centre*, procédait par cercles concentriques, en recherchant sans cesse son point d'appui, son point de fuite ou de rupture, pour toucher l'essentiel : le cœur absolu des choses. On y croisait des visages familiers : Copernic, Freud, mais aussi Dante et Shakespeare (déjà!) et l'inoubliable Comte de Lautréamont, auteur mystérieux des Chants de Maldoror.
Tout commence, ici, dans Le Nouveau**, par le vol un peu fou d'une mouette, une mouette rieuse, qui fait mine d'attaquer le narrateur qui rêve sur une plage de l'Atlantique. Aucune agressivité, juste un signal. Sollers, qui s'y connaît en écritures, y voit tout de suite un message, sans doute venu de la nuit des temps : une mouette, la plage, une barque échouée au fond du jardin, qui servait à rejoindre le bateau que Louis, l'arrière-grand-père, avait baptisé La Nouveau.
Il n'en faut pas davantage pour embarquer avec lui dans ce roman qu'on pourrait dire familial, car les personnages sont tous issus de la famille Sollers.
 Il y a Henri, le navigateur, et sa femme Edna, l'Irlandaise. Il y a aussi Louis, l'escrimeur, et Lena, la magicienne. C'est le point de départ — le carré magique — du nouveau roman de Philippe Sollers : une interrogation sur le passage, la transmission, la fuite du temps qui s'ingénie à tourner sur lui-même, à revenir en arrière, mais demeure aspiré sans cesse par le nouveau. Pour Henri, ce sont les voyages au long cours, la navigation autour du monde, mais aussi la rencontre avec l'étrangère, Edna, qui deviendra sa femme. Pour Louis, c'est la passion du jeu et de l'escrime, de la lecture et du silence.
Il y a Henri, le navigateur, et sa femme Edna, l'Irlandaise. Il y a aussi Louis, l'escrimeur, et Lena, la magicienne. C'est le point de départ — le carré magique — du nouveau roman de Philippe Sollers : une interrogation sur le passage, la transmission, la fuite du temps qui s'ingénie à tourner sur lui-même, à revenir en arrière, mais demeure aspiré sans cesse par le nouveau. Pour Henri, ce sont les voyages au long cours, la navigation autour du monde, mais aussi la rencontre avec l'étrangère, Edna, qui deviendra sa femme. Pour Louis, c'est la passion du jeu et de l'escrime, de la lecture et du silence.
Est-ce pour cela, et à cause d'eux, que le narrateur ressent depuis toujours le besoin d'embarquer pour de nouveaux rivages, de déchiffrer de nouveaux signes, d'aimer l'escrime et les bateaux ? « Sur la scène invisible du Nouveau, tout s'éclaire, tout s'explique. La mort elle-même devient amoureuse de la parole qu'elle porte. »
Comme toujours, on navigue en joyeuse compagnie. Ici, Shakespeare nous accompagne dans les tempêtes comme dans les calmes plats. Sollers revisite son théâtre et sa vie, à commencer par sa mère, Mary, qui eut neuf enfants, et par son père, aux abonnés absents, à une époque où « le Nom du Père était roi, on priait constamment pour lui, on rêvait de le tuer, il devenait fou sur la scène. » William le sent, le sait, il va le dire dans son théâtre.
Des Sonnets érotiques à La Nuit des Rois, en passant par Hamlet et Othello, William n'aura de cesse de brasser le désir, de le tordre, de le défigurer. « Je suis mon désir, je veux mon désir, le désir me veut, tous les désirs me veulent. J'ai la volonté de mon désir, vous serez forcés de m'aimer puisque mon nom est désir (WILL I AM). Dans la corruption générale et même si je pourris, anonyme, dans une tombe. »
 Dans un va-et-vient constant entre le réel et l'imaginaire, les épisodes biographiques et les éclairages littéraires, Sollers traque à sa manière le « dieu nouveau ». Celui que chaque époque se donne, le dieu jaloux qui demande un sacrifice absolu. « Le dieu nouveau ne dit jamais « nous », ne s'adresse à aucune communauté particulière, ne parle pas de sauver le monde ou l'humanité. Comme c'est un dieu extrême, il choisit uniquement des singularités. Celles-ci sont aussi différentes que possible, si elles se rencontraient, elles n'auraient rien à se dire. L'extrême de X n'est pas celui de Y, et encore moins celui de G ou de Z. »
Dans un va-et-vient constant entre le réel et l'imaginaire, les épisodes biographiques et les éclairages littéraires, Sollers traque à sa manière le « dieu nouveau ». Celui que chaque époque se donne, le dieu jaloux qui demande un sacrifice absolu. « Le dieu nouveau ne dit jamais « nous », ne s'adresse à aucune communauté particulière, ne parle pas de sauver le monde ou l'humanité. Comme c'est un dieu extrême, il choisit uniquement des singularités. Celles-ci sont aussi différentes que possible, si elles se rencontraient, elles n'auraient rien à se dire. L'extrême de X n'est pas celui de Y, et encore moins celui de G ou de Z. »
On croise encore, un peu plus loin, dans cette navigation aventureuse, André Breton et sa bande de surréalistes (l'adjectif le plus galvaudé de notre époque), « C'est à croire qu'une coalition est toujours prête à se former pour qu'il ne se passe rien. » Rien ne se passe ; pourtant, quelque chose arrive. Que tout le monde attend depuis toujours (l'attente est une des conditions de son apparition), dans le silence ou la tempête qui fait rage, sur une plage de l'Atlantique, sous le rire des mouettes : cela s'appelle le Nouveau.
* Philippe Sollers, Centre, roman, Gallimard, 2018.
** Philippe Sollers, Le Nouveau, roman, Gallimard, 2019.
À ne pas manquer : Josyane Savigneau publie ce mois-ci un livre d'entretiens avec Philippe Sollers, Une conversation infinie, Bayard, 2019.