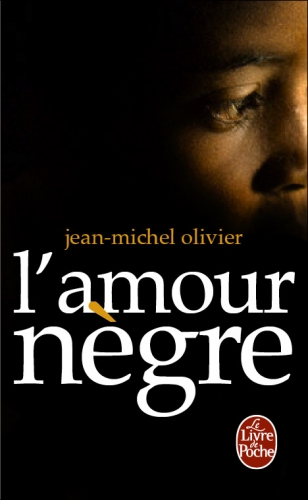J’ai vécu l’âge de glace du roman – et j’y ai survécu! À l’université régnait en maître le roman dit «nouveau», autrement dit: sa négation. « Plus de récit, non, jamais »: l’injonction de Maurice Blanchot semblait définitive: on n’avait plus le droit de raconter des histoires, ou alors, si on persistait dans l’erreur, il fallait que ces histoires soient subtilement déconstruites, pour ne pas dire illisibles. Le roman était mort: Alain Robbe-Grillet et ses joyeux comparses avaient cloué à jamais le cercueil.
Quand on veut écrire, malgré tout, il faut se débarrasser des injonctions, surtout universitaires. Oublier le «nouveau roman», qui n’est qu’une époque de la littérature, et pas la plus émoustillante. C’est une tâche passionnante: on découvre alors tous les auteurs mis au rebut ou simplement oubliés par l’alma mater. Les auteurs mal famés comme l’odieux et génial Céline, le subtil Paul Morand, la vénéneuse Violette Leduc – et même Françoise Sagan, épinglée à jamais dans la catégorie des écrivains frivoles (mais quelle grâce!).
Lire aussi: Joyce Carol Oates tisse une trame sulfureuse à la lumière des neurosciences
A l’université, la littérature romande n’a jamais eu qu’un strapontin. Elle représentait une littérature exotique, ataviquement attachée au terroir, sans visée universelle, prisonnière de ses tics et de ses tournures locales. Quel dommage! Pour l’écrivain en devenir, l’école buissonnière était obligatoire et passait par la découverte des livres de Chessex et de Chappaz, de Bouvier et de Corinna Bille, de Germain Clavien et de Pierre Girard, de Georges Haldas et de Jean Vuilleumier. Autant de voix uniques et singulières. Autant de territoires inconnus, à des années-lumière de la doxa, qui ouvraient, pour le lecteur avide, de nouveaux horizons, où l’air était plus frais et la vie plus sauvage.
Ces horizons illimités, je les ai connus en 1995 quand je fus invité par l’Université du Michigan, à Ann Arbor. J’étais chargé de donner un cours sur la littérature suisse: Rousseau, Ramuz, Chessex, Corinna Bille, Bouvier, auxquels on avait rattaché, par nécessité pédagogique, Monsieur de Voltaire, qui était au programme des examens! Autant dire que pour mes étudiants des grandes plaines j’enseignais une manière de chinois! Je profitai de mon séjour pour lire les écrivains qui attendaient depuis longtemps sur ma table de chevet. J’étais au Michigan, il me fallait lire aussi les écrivains du cru, les mieux à même de me faire découvrir le génie des lieux.
Lire aussi: Joyce Carol Oates lâche le diable dans l’Amérique puritaine
C’est ainsi que j’ai découvert Joyce Carol Oates, le plus grand écrivain américain vivant. J’ai commencé par Solstice, le récit d’une amitié insolite entre deux femmes qui s’attirent et s’affrontent, sur fond de création artistique (l’une d’elles est sculptrice). Puis j’ai continué avec Le pays des merveilles. Puis Amours profanes, Haute Enfance, Le goût de l’Amérique. La liste est longue des livres lus et encore à lire, puisque cette femme d’allure si frêle a publié près de 70 ouvrages – récits, romans, pièces de théâtre, essais – et usé de plusieurs pseudonymes, dont Rosamond Smith et Lauren Kelly!
Impossible, donc, d’en faire le tour: Joyce Carol Oates, née le 16 juin 1938 (le jour du Bloomsday!) dans l’Etat de New York, épuise, par la richesse de son œuvre, les lecteurs les plus aguerris – sans parler de ses éditeurs, ni de ses traducteurs qui peinent à suivre les ramifications de cette œuvre monstre.
Le réalisme est la lèpre de la littérature. Chaque livre puise ses racines dans le réel, mais il ne doit jamais s’y enferrer, ni s’y enterrer. C’est la force des romans de Joyce Carol Oates: ils commencent par un cri, un geste suspendu, une scène de cauchemar (un enfant que sa mère tente de noyer dans la boue dans Mudwoman). Ils sont ancrés dans le réel.
Mais l’auteure abandonne assez vite la piste réaliste ou sociologique. Ce réel, alors, se révèle hanté de forces obscures, violentes, contradictoires. C’est une glu dont il faut s’échapper. Il s’ouvre au fantastique et au «gothique», comme on dit aujourd’hui (relisez Maupassant: il ne fait pas autre chose). L’auteure apprend à démasquer les pièges du monde et à les déjouer. C’est un jeu infernal. Elle ne prend jamais parti. Elle dit le bien comme le mal, imperturbablement, sans se soucier de la doxa à la mode (c’est pourquoi beaucoup de ses livres ont fait scandale). Ses personnages sont déchirés, abandonnés, en quête de rédemption: le plus souvent, ce sont des femmes, qui réussissent le prodige de s’en sortir, de se sauver, alors que tout conspirait à leur perte.
Joyce Carol Oates, pour tous les écrivains, c’est l’exemple d’une liberté souveraine.
Jean-Michel Olivier
© Le Temps, 2019.
@ dessin : Frassetto.