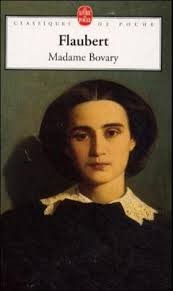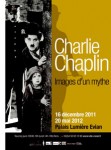C'est un livre* sans chichis, une confession jouée, sans doute (comment pourrait-il en être autrement avec le plus grand acteur français vivant ?), mais émouvante, directe et bien écrite (l'excellent Lionel Duroy joue ici les nègres de luxe). Un livre qui vous attrape dès la première ligne et qui ne vous lâche pas…
C'est un livre* sans chichis, une confession jouée, sans doute (comment pourrait-il en être autrement avec le plus grand acteur français vivant ?), mais émouvante, directe et bien écrite (l'excellent Lionel Duroy joue ici les nègres de luxe). Un livre qui vous attrape dès la première ligne et qui ne vous lâche pas…
Dans Ça s'est fait comme ça*, autobiographie brève et intense, Gérard Depardieu revient sur son destin singulier, son enfance pauvre (mais heureuse), sa jeunesse de petite frappe (les flics de Châteauroux l'appelaient par son prénom), ses déboires sentimentaux — mais surtout sa soif de liberté. C'est le livre d'un homme longtemps privé de langage (autiste et quasi aphasique) qui, grâce à quelques rencontres miraculeuses (le comédien Jean-Laurent Cochet, par exemple, ou le docteur Tomatis), trouve les mots pour se dire — et exprimer le monde merveilleux qu'il porte en soi.
On sait tout, déjà, de ce Pantagruel ivre de vin et de femmes, de ses excès, de ses colères, de ses passions, qui a longtemps donné à son pays près de 87% de ses revenus et s'est fait traiter de « minable » par un premier ministre dont le monde a déjà oublié le nom.  On apprend dans son livre que le chemin vers la vraie liberté passe toujours par les mots. Les livres rendent libres. Les Romains le savaient déjà qui aimaient à jouer sur le double sens du mot « liber », à la fois livre et libre.
On apprend dans son livre que le chemin vers la vraie liberté passe toujours par les mots. Les livres rendent libres. Les Romains le savaient déjà qui aimaient à jouer sur le double sens du mot « liber », à la fois livre et libre.
Il faut lire ce livre gorgé de vie qui résonne comme un immense éclat de rire : « Et après, je prends sur moi tous les chagrins. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis comme ça. Tu ne peux pas changer les rayures du zèbre. » Ou encore, à propos du film Danton de Wajda : « Ça, c'est mon élan profond : ne pas savoir ce qui va arriver, ce que je vais faire ou dire, mais marcher vers l'inconnu avec cet appétit pour la vie que chaque instant me porte. »
Depardieu, évoquant les rencontres marquantes de sa vie, parle admirablement de Claude Régy, de la minuscule Marguerite Duras (qui lui arrive à la ceinture) et de l'immense Peter Handke. Chacun lui a donné les mots de son destin.
« Oublie ta famille, écrit l'écrivain autrichien, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne, fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. »
Quelle leçon !
* Gérard Depardieu, Ça s'est fait comme ça, éditions XO, 2014.