 Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film.
Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film.
La critique, c'est le sujet du dernier film du lausannois Lionel Baier, intitulé Un autre homme. L'auteur, qui se flatte de n'avoir obtenu aucune subside de Berne (et d'avoir ainsi préservé sa liberté), raconte la vie d'un critique de cinéma, vivant dans la vallée de Joux (autrement dit, un trou perdu) qui, au lieu d'aller voir les films qu'il doit chroniquer, se contente de recopier la critique qu'il lit dans un magazine français spécialisé. Acide et drôle, le film fait allusion au milieu romand des critiques (et plus spécialement, semble-t-il, au critique du Temps, Thierry Jobin, dont le personnage principal du film est une caricature). Son accueil, dans la presse, on l'imagine, très mitigé. Les critiques n'aiment pas qu'on les critique! Cela va de « film à éviter » (Le Matin) à « film à découvrir » (La Tribune de Genève). Difficile donc, en lisant les critiques, de se faire une idée précise de la chose, d'autant que certains papiers sentent le règlement de compte à plein nez…
Et les autres films?
Prenez le dernier Sam Mendes, Noces rebelles, qui reforme à l'écran le couple mythique de Titanic, Kate Winslet et Leonardo di Caprio.  Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).
Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).
Dernier exemple édifiant, le dernier film de Danny Boyle, intitulé Slumdog millionnaire, qui raconte le destin d'un jeun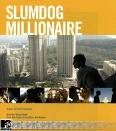 e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…
e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…
Alors, dites-moi, à quoi servent les critiques quand ils ne passent pas les plats?
 Alors que les États-Unis fêtent avec panache leur nouveau président, dans un show très hollywoodien (avec quelques guests stars comme Dustin Hoffman, Leonardo di Caprio, Bruce Springsteen), la Suisse fait son cinéma à Soleure. Bien sûr, cela n'a rien à voir : c'est modeste, discret, plein de rancunes et de rancœurs, d'obscurs metteurs en scène et d'éphémères starlettes. Comme on le rappelle à l'envi, le cinéma suisse a connu ses heures de gloire dans les années 70-80, autour de la brillante équipe des Tanner, Goretta, Soutter et autres Yersin. Depuis, il cherche un second souffle. Et surtout un patron, réclamé cependant par toute la profession. Ce patron a été nommé : il s'agit de Nicolas Bideau, fils de. En quelques années, Bideau a réussi à décupler le budget alloué au cinéma par la Confédération, qui reste le principal pourvoyeur de fonds du 7ème art en Suisse. Il a voulu aussi mettre en place une nouvelle politique du cinéma (réclamée par tous les réalisateurs) en misant sur certains films davantage « grand public » que les films suisses traditionnels. À ce jeu-là, il a connu de belles réussites (Eugen, Vitus, Grounding, Home) et quelques échecs (Max & Co). Plusieurs réalisateurs ont saisi ce prétexte pour réclamer la tête de Nicolas Bideau : trop autoritaire, trop bavard, pas assez suisse. Après avoir supplié qu'on leur donne un père, ils veulent maintenant l'abattre. C'est de bonne guerre. Prisonniers de leur autisme, ils ne veulent pas quitter leur petite marge où ils règnent en maîtres. Vincent Plüss vaut-il mieux que Freddy Murer? Le noir et blanc de Lionel Baier fait-il oublier celui de Tanner ou de Godard? Notre cinéma est-il exportable ou ne doit-il s'adresser qu'à ceux qui le subventionnent? Vastes questions. La grogne qui règne à Soleure montre bien qu'il y a un débat. Tant mieux. C'est la preuve que le cinéma suisse est encore vivant. Mais à force de vouloir tuer le Père (grande gueule comme Jean-Luc), ceux qui mènent la fronde risquent un jour de se retrouver orphelins, sans moyens, sans famille, sans personne à qui adresser leurs jérémiades. Ce jour-là sera vraiment dramatique. Il signera la mort du cinéma suisse.
Alors que les États-Unis fêtent avec panache leur nouveau président, dans un show très hollywoodien (avec quelques guests stars comme Dustin Hoffman, Leonardo di Caprio, Bruce Springsteen), la Suisse fait son cinéma à Soleure. Bien sûr, cela n'a rien à voir : c'est modeste, discret, plein de rancunes et de rancœurs, d'obscurs metteurs en scène et d'éphémères starlettes. Comme on le rappelle à l'envi, le cinéma suisse a connu ses heures de gloire dans les années 70-80, autour de la brillante équipe des Tanner, Goretta, Soutter et autres Yersin. Depuis, il cherche un second souffle. Et surtout un patron, réclamé cependant par toute la profession. Ce patron a été nommé : il s'agit de Nicolas Bideau, fils de. En quelques années, Bideau a réussi à décupler le budget alloué au cinéma par la Confédération, qui reste le principal pourvoyeur de fonds du 7ème art en Suisse. Il a voulu aussi mettre en place une nouvelle politique du cinéma (réclamée par tous les réalisateurs) en misant sur certains films davantage « grand public » que les films suisses traditionnels. À ce jeu-là, il a connu de belles réussites (Eugen, Vitus, Grounding, Home) et quelques échecs (Max & Co). Plusieurs réalisateurs ont saisi ce prétexte pour réclamer la tête de Nicolas Bideau : trop autoritaire, trop bavard, pas assez suisse. Après avoir supplié qu'on leur donne un père, ils veulent maintenant l'abattre. C'est de bonne guerre. Prisonniers de leur autisme, ils ne veulent pas quitter leur petite marge où ils règnent en maîtres. Vincent Plüss vaut-il mieux que Freddy Murer? Le noir et blanc de Lionel Baier fait-il oublier celui de Tanner ou de Godard? Notre cinéma est-il exportable ou ne doit-il s'adresser qu'à ceux qui le subventionnent? Vastes questions. La grogne qui règne à Soleure montre bien qu'il y a un débat. Tant mieux. C'est la preuve que le cinéma suisse est encore vivant. Mais à force de vouloir tuer le Père (grande gueule comme Jean-Luc), ceux qui mènent la fronde risquent un jour de se retrouver orphelins, sans moyens, sans famille, sans personne à qui adresser leurs jérémiades. Ce jour-là sera vraiment dramatique. Il signera la mort du cinéma suisse. Injustement négligée, l’œuvre de Michel Soutter (1932-1991), d’abord chansonnier, puis auteur de théâtre, réalisateur de télévision et de cinéma, méritait un nouvel intérêt. C’est chose faite avec le beau livre d’Éric Eigenmann, Poétique de Nichel Soutter *, qui analyse, de manière rigoureuse et documentée, l’importance de la parole dans les films de Soutter. Au cinéma comme au théâtre, Michel Soutter a fait œuvre avant tout de poète, inspiré par les surréalistes et le théâtre russe. Ce qui fait à la fois la force de son style et sa parfaite singularité. Entretien.
Injustement négligée, l’œuvre de Michel Soutter (1932-1991), d’abord chansonnier, puis auteur de théâtre, réalisateur de télévision et de cinéma, méritait un nouvel intérêt. C’est chose faite avec le beau livre d’Éric Eigenmann, Poétique de Nichel Soutter *, qui analyse, de manière rigoureuse et documentée, l’importance de la parole dans les films de Soutter. Au cinéma comme au théâtre, Michel Soutter a fait œuvre avant tout de poète, inspiré par les surréalistes et le théâtre russe. Ce qui fait à la fois la force de son style et sa parfaite singularité. Entretien.