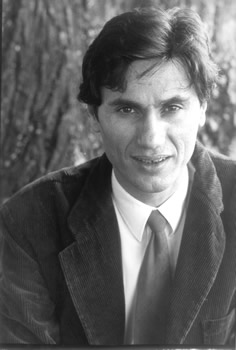On le sait depuis toujours : la meilleure façon, pour un artiste, de passer à la postérité, c’est de créer — si possible de son vivant — son propre mythe : regardez Duras, Bouvier, Chessex, Balthus…
Rendons grâce à Balthus : par une fine stratégie, à la fois de retrait et d’exhibition, une constante réécriture de son propre travail, il aura berné tout le monde ! À tous ceux qui l’accusent de peindre des jeunes filles dévêtues aux poses alanguies, il répond qu’il ne faut voir dans ses toiles que des anges et des apparitions. Et que sa peinture est uniquement d’essence religieuse ! Mais faut-il le croire ? Le journaliste et écrivain Raphaël Aubert se penche sur la question dans un livre excellent*.
Qu’en est-il de ce peintre à la fois provocateur et archiclassique, dans lequel certains n’hésitent pas à reconnaître le dernier représentant de la tradition figurative occidentale ? Pas à pas, Raphaël Aubert déplie et interroge le mythe Balthus en racontant sa vie, tout d’abord, ses influences (le poète Rilke qui fut l’amant de sa mère, et une sorte de père idéal ; Artaud, Malraux) et déjà cette propension non seulement au mythe, mais aussi à la mystification (de même qu’il s’inventa une blessure l’obligeant à quitter le front de la guerre en 1939, le peintre de Rossinière s’affubla de particules ronflantes, comme le fameux titre de Prince Klossowki-Rola, une pure affabulation !).
En relisant les grands tableaux de Balthus, en particulier La Leçon de guitare (1934), Aubert rend hommage au peintre, qui veut « déclamer au grand jour, avec sincérité et émotion, tout le tragique palpitant d’un drame de la chair, proclamer à grands cris les lois inébranlables de l’instinct ». Ces déclarations, particulièrement éclairantes, Balthus les fait en 1933, alors qu’il n’est pas encore connu, et qu’il est insoucieux de son propre mythe. Revisitant ses grandes toiles, le même Balthus déclarera à la fin de sa vie : « Les gens pensent (de ma peinture) que c’est de l’érotisme. C’est parfaitement absurde. Ma peinture est essentielle et profondément religieuse. »
On voit le grand écart entre ces deux déclarations, et comment Balthus, effaçant le scandale de ses première toiles, tente à présent de bâtir le mythe d’un peintre classique, pour qui « peindre est une prière », et qui se voit lui-même quelque part entre Vermeer et Piero della Francesca. Raphaël Aubert décrypte admirablement ce double langage, qui pourrait rendre Balthus insupportable, s’il n’était pas, d’évidence, un grand peintre.
Pourquoi ce désir de réappropriation ? demande Aubert. Par simple souci de conformisme ? Pour préserver le mystère d’une œuvre qui pourrait apparaître comme triviale ? Ou parce que « son contenu — biographique, érotique, mais aussi esthétique — avance Aubert, est à proprement parler inavouable » ? Et le fait est qu’aujourd’hui encore les tableaux de Balthus, dans leur classicisme outré, ont comme un parfum de scandale…
Rendons grâce à Balthus : par une fine stratégie, à la fois de retrait et d’exhibition, une constante réécriture de son propre travail, il aura berné tout le monde ! À tous ceux qui l’accusent de peindre des jeunes filles dévêtues aux poses alanguies, il répond qu’il ne faut voir dans ses toiles que des anges et des apparitions. Et que sa peinture est uniquement d’essence religieuse ! Mais faut-il le croire ? Le journaliste et écrivain Raphaël Aubert se penche sur la question dans un livre excellent*.
Qu’en est-il de ce peintre à la fois provocateur et archiclassique, dans lequel certains n’hésitent pas à reconnaître le dernier représentant de la tradition figurative occidentale ? Pas à pas, Raphaël Aubert déplie et interroge le mythe Balthus en racontant sa vie, tout d’abord, ses influences (le poète Rilke qui fut l’amant de sa mère, et une sorte de père idéal ; Artaud, Malraux) et déjà cette propension non seulement au mythe, mais aussi à la mystification (de même qu’il s’inventa une blessure l’obligeant à quitter le front de la guerre en 1939, le peintre de Rossinière s’affubla de particules ronflantes, comme le fameux titre de Prince Klossowki-Rola, une pure affabulation !).
En relisant les grands tableaux de Balthus, en particulier La Leçon de guitare (1934), Aubert rend hommage au peintre, qui veut « déclamer au grand jour, avec sincérité et émotion, tout le tragique palpitant d’un drame de la chair, proclamer à grands cris les lois inébranlables de l’instinct ». Ces déclarations, particulièrement éclairantes, Balthus les fait en 1933, alors qu’il n’est pas encore connu, et qu’il est insoucieux de son propre mythe. Revisitant ses grandes toiles, le même Balthus déclarera à la fin de sa vie : « Les gens pensent (de ma peinture) que c’est de l’érotisme. C’est parfaitement absurde. Ma peinture est essentielle et profondément religieuse. »
On voit le grand écart entre ces deux déclarations, et comment Balthus, effaçant le scandale de ses première toiles, tente à présent de bâtir le mythe d’un peintre classique, pour qui « peindre est une prière », et qui se voit lui-même quelque part entre Vermeer et Piero della Francesca. Raphaël Aubert décrypte admirablement ce double langage, qui pourrait rendre Balthus insupportable, s’il n’était pas, d’évidence, un grand peintre.
Pourquoi ce désir de réappropriation ? demande Aubert. Par simple souci de conformisme ? Pour préserver le mystère d’une œuvre qui pourrait apparaître comme triviale ? Ou parce que « son contenu — biographique, érotique, mais aussi esthétique — avance Aubert, est à proprement parler inavouable » ? Et le fait est qu’aujourd’hui encore les tableaux de Balthus, dans leur classicisme outré, ont comme un parfum de scandale…
* Le Paradoxe Balthus, par Raphaël Aubert, La Différence, 2005.