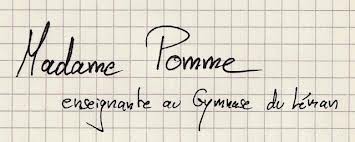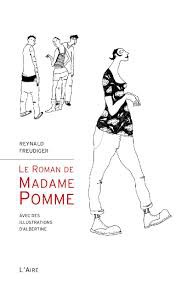Peu de textes, aujourd’hui, vous prennent à la gorge comme le dernier livre de Pascal Bruckner, intitulé Un bon fils*, qui trace une sorte de portrait croisé, en miroir, du père Bruckner par son fils Pascal, portrait sévère, mais juste, sans concession, d’une honnêteté et d’une intelligence très rares.
Peu de textes, aujourd’hui, vous prennent à la gorge comme le dernier livre de Pascal Bruckner, intitulé Un bon fils*, qui trace une sorte de portrait croisé, en miroir, du père Bruckner par son fils Pascal, portrait sévère, mais juste, sans concession, d’une honnêteté et d’une intelligence très rares.
Dans une œuvre riche et dense, composée d’essais brillants (comme La Tentation de l’innocence, 1995) et de romans très singuliers (comme Lune de fiel, 1981, adapté au cinéma par Roman Polanski,  ou Les Voleurs de beauté, 1997), Pascal Bruckner poursuit, depuis trente ans, une réflexion sur nos hantises et nos remords (Le Sanglot de l’Homme blanc), nos rêves d’innocence, nos paradoxes amoureux et nos désirs d’apocalypse. Sa pensée est souvent fulgurante, et volontiers provocatrice : Bruckner ne se range pas parmi les bien-pensants. Sur tous les sujets qu’il aborde, il jette une lumière nouvelle, inattendue, qui prend tout le monde à contre-pied.
ou Les Voleurs de beauté, 1997), Pascal Bruckner poursuit, depuis trente ans, une réflexion sur nos hantises et nos remords (Le Sanglot de l’Homme blanc), nos rêves d’innocence, nos paradoxes amoureux et nos désirs d’apocalypse. Sa pensée est souvent fulgurante, et volontiers provocatrice : Bruckner ne se range pas parmi les bien-pensants. Sur tous les sujets qu’il aborde, il jette une lumière nouvelle, inattendue, qui prend tout le monde à contre-pied.
Avec Un bon fils, l’essayiste français nous donne son meilleur livre : le plus personnel, à la fois, le plus cru et le plus cruel. Celui qu’il se devait d’écrire. Pour s’affranchir du fantôme de son père, d’abord, ce fantôme aliénant, infréquentable, et pour enfin être lui-même.
C’est peu dire que Bruckner, comme tant d’autres, règle ses comptes avec son père — mari volage et violent, nostalgique de Vichy et antisémite forcené — : en même temps, c’est la force du livre, il lui rend grâces de sa violence et de ses haines, de l’éternelle colère de l’homme déclassé et ruiné à la fin de sa vie : cet homme qui avait tellement peur qu’on prenne son fils unique pour un Juif…
 Un bon fils est à la fois un portrait terrifiant et lucide (le père), une autobiographie qui raconte la naissance d’une personnalité (le fils) et un roman de formation qui montre comment, à partir d’une enfance abusée (coups, menaces, corrections diverses) on peut tout de même s’en sortir, et aller jusqu’au bout de sa liberté. «Rentrer dans l’intimité de notre famille, c’était comme soulever une pierre sous laquelle grouillent les scorpions. » Et Bruckner de soulever, l’une après l’autre, avec peur et fascination, toutes les pierres qui forment l’édifice familial…
Un bon fils est à la fois un portrait terrifiant et lucide (le père), une autobiographie qui raconte la naissance d’une personnalité (le fils) et un roman de formation qui montre comment, à partir d’une enfance abusée (coups, menaces, corrections diverses) on peut tout de même s’en sortir, et aller jusqu’au bout de sa liberté. «Rentrer dans l’intimité de notre famille, c’était comme soulever une pierre sous laquelle grouillent les scorpions. » Et Bruckner de soulever, l’une après l’autre, avec peur et fascination, toutes les pierres qui forment l’édifice familial…
Né dans un famille « bilingue dès le berceau », ayant appris l’antisémitisme en même temps que le français, Pascal va chercher très vite à sortir de la geôle familiale. Par la maladie, d’abord, la tuberculose, qui l’obligera à fréquenter les sanatoriums des Alpes suisses (Leysin). Par ses études, ensuite, qu’il poursuivra à Paris, entre autres avec Roland Barthes, loin de ce père toxique et de cette mère qui « se punit pour punir son mari ». Les livres demeurent une arme sans égale contre la tyrannie et le meilleur moyen de chasser ses démons.
« Comment sortir de son enfance ? Par la révolte et par la fuite, mais surtout par l’attraction : en multipliant les passions qui vous jettent dans le monde. La liberté, c’est d’additionner les dépendances ; la servitude, d’être limité à soi. »
À la fois détestable et fascinante (un père reste un père !), la figure paternelle, longtemps tenue à distance, revient hanter son fils à la fin de sa vie. Son épouse est morte (en mourant, à ses yeux, elle est devenue une sainte !), il est grevé de dettes et il devient peu à peu un Diogène acariâtre et pouilleux. Pascal, en bon fils, va s’occuper de ce père encombrant à qui il conseille, malgré tout, de faire un Stefan Zweig — autrement dit : de se suicider…
Chaque fils, qu’il le veuille ou non, devient un jour le père de son père. C’est inscrit dans nos gènes : le lot de notre humanité. C’est ainsi que Pascal, parfois désemparé face à ce père qui fanfaronne à l’hôpital, insulte les infirmières africaines et doit subir plusieurs amputations, ne lâchera jamais prise. Il accompagnera jusqu’au bout ce père qui rêve de « la domination mondiale de la race aryenne et du règne de la Bête de proie ».
Magnifiques pages, à la mort du tyran, écrites par un fils qui refuse d’être le bourreau de son père. « Je n’ai qu’une certitude : mon père m’a permis de penser mieux en pensant contre lui. Je suis sa défaite : c’est le plus beau cadeau qu’il m’ait fait. »
Et enfin : « J’espère rester immortel jusqu’à mon dernier souffle. »
Un grand livre.
* Pascal Bruckner, Un bon fils, Grasset, 2014.