 C’est une malédiction qui revient chaque année en novembre, comme le Beaujolais nouveau : les Prix littéraires. Impossible d’y échapper. Les éditeurs français misent tous leurs sous sur la rentrée de l’automne. Et les journaux, qui ne s’intéressent jamais à la littérature le reste de l’année, se lancent dans le jeu des pronostics. Qui aura le Prix Femina ? Qui le Renaudot ? Et qui le Goncourt, surtout, le plus prisé de tous les Prix, moins pour le talent qu’il consacre que pour les tirages faramineux qu’il laisse espérer à son éditeur.
C’est une malédiction qui revient chaque année en novembre, comme le Beaujolais nouveau : les Prix littéraires. Impossible d’y échapper. Les éditeurs français misent tous leurs sous sur la rentrée de l’automne. Et les journaux, qui ne s’intéressent jamais à la littérature le reste de l’année, se lancent dans le jeu des pronostics. Qui aura le Prix Femina ? Qui le Renaudot ? Et qui le Goncourt, surtout, le plus prisé de tous les Prix, moins pour le talent qu’il consacre que pour les tirages faramineux qu’il laisse espérer à son éditeur.
Car les Prix sont d’abord une affaire de sous. Surtout à notre époque où les librairies se font rares, où certains éditeurs cachent mal leur misère, mendient des subventions ou mettent simplement la clé sous la porte. Un Prix permet de voir venir. D’éditer d’autres livres, tout aussi estimables qu’un best-seller, mais qui auront moins de succès.  Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.
Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.
À ce jeu, certains, même, deviennent fous. C’est le cas des médias français qui dégomment ou encensent, selon leur bon caprice ou leur bord politique, les prétendants aux récompenses suprêmes. Christine Angot idolâtrée par Libération et massacrée par le Figaro. Ou l’inverse pour Joël Dicker, salué par Le Point et descendu par Le Nouvel Observateur. Les Prix rendent fous. Les éditeurs qui jouent parfois à quitte ou double. Les écrivains qui alignent les sottises, à longueur d’interviews, comme on enfile les perles d’un collier. Les journalistes enfin, prêts à tout pour défendre leur poulain. Comme Raphaël Aubert, qu’on a connu mieux inspiré, prophétisant sur les ondes de la RTS aux petites heures du matin « la seconde mort de Jacques Chessex. » Décidément, la vengeance est un plat qui se mange froid…
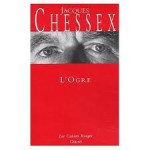 Chessex, parlons-en ! Il a obtenu le Goncourt en 1973 pour un roman, L’Ogre, qui a beaucoup fait jaser en Suisse romande par sa violence, son impudeur, sa verve provocante. Le premier et le seul Goncourt suisse. À l’époque, un coup de maître. Ensuite, logiquement, une longue traversée du désert. De bons, voire de très bons romans, mais moins d’échos. Car après le Goncourt, comme on sait, il n’y a rien. Peu d’écrivains y ont survécu. Chessex, oui, car c’était un grand écrivain, qui venait de la poésie. Comme Pascal Quignard ou Michel Houellebecq.
Chessex, parlons-en ! Il a obtenu le Goncourt en 1973 pour un roman, L’Ogre, qui a beaucoup fait jaser en Suisse romande par sa violence, son impudeur, sa verve provocante. Le premier et le seul Goncourt suisse. À l’époque, un coup de maître. Ensuite, logiquement, une longue traversée du désert. De bons, voire de très bons romans, mais moins d’échos. Car après le Goncourt, comme on sait, il n’y a rien. Peu d’écrivains y ont survécu. Chessex, oui, car c’était un grand écrivain, qui venait de la poésie. Comme Pascal Quignard ou Michel Houellebecq.
Comme pour le Beaujolais nouveau, il y a de bonnes et de moins bonnes années. 2012 n’aura pas été un grand cru. Qui se souviendra encore de Patrick Deville (Prix Femina) ou de Jérôme Ferrari (Prix Goncourt) dans quelques années ? Qui se souvient des lauréats de l’an dernier ? Ouvrons les paris.
Ainsi tourne la valse des Prix, une valse à mille temps, dont Paris bat la mesure, comme chaque automne, et qui ressemble à un roman.
 C’était un soir d'hiver assez triste. Il y a presque deux ans. Dans sa librairie Le Rameau d'Or, Dimitri n'avait autour de lui que très peu d'écrivains dont j'étais et pratiquement aucun journaliste. On était loin, très loin de ces soirées d'autrefois où l’on était assis, fesse à fesse, pour présenter nos bouquins dans un espace qui manquait. Dans cette librairie, il faisait bon se faire voir alors, du monde de la plume et des médias.
C’était un soir d'hiver assez triste. Il y a presque deux ans. Dans sa librairie Le Rameau d'Or, Dimitri n'avait autour de lui que très peu d'écrivains dont j'étais et pratiquement aucun journaliste. On était loin, très loin de ces soirées d'autrefois où l’on était assis, fesse à fesse, pour présenter nos bouquins dans un espace qui manquait. Dans cette librairie, il faisait bon se faire voir alors, du monde de la plume et des médias.  Haldas avait sa cour. Frochaux était en verve. On picolait gaiement autour d’assiettes de chips.
Haldas avait sa cour. Frochaux était en verve. On picolait gaiement autour d’assiettes de chips.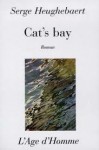 Pas un seul journaliste. Tatoué ou non. Du moins, au moment où j’y étais.
Pas un seul journaliste. Tatoué ou non. Du moins, au moment où j’y étais. De son nuage, il doit sourire, de toutes les manigances, les simagrées, les sourires hypocrites, les éloges funèbres, le Barbare qui fut si longtemps blacklisté par les journaux français, comme suisses, pour ses « opinions politiques », lui qui surtout fut le passeur des plus grands textes russes (Grossman, Zinoviev), slaves (Tsernianski), mais aussi romands (Haldas, Barillier, Vuilleumier, Monique Laederach, Bernadette Richard, Fontanet, Kuffer, Frochaux, Albanese et tant d'autres), il doit sourire aux articles des demoiselles du Temps qui s'extasient sur le « renouveau des lettres romandes », alors qu'il l'annonçait depuis 30 ans, ce renouveau, et qu'elles n'ont rien vu venir (et pour cause, elles ignoraient ses livres), il doit sourire, entouré de ses popes aux longues barbes, de tous ces brusques revirements, lui qui a enduré insultes, mépris et silences gênés, il a fallu qu'il meure pour qu'on ose à nouveau prononcer son nom : Dimitri.
De son nuage, il doit sourire, de toutes les manigances, les simagrées, les sourires hypocrites, les éloges funèbres, le Barbare qui fut si longtemps blacklisté par les journaux français, comme suisses, pour ses « opinions politiques », lui qui surtout fut le passeur des plus grands textes russes (Grossman, Zinoviev), slaves (Tsernianski), mais aussi romands (Haldas, Barillier, Vuilleumier, Monique Laederach, Bernadette Richard, Fontanet, Kuffer, Frochaux, Albanese et tant d'autres), il doit sourire aux articles des demoiselles du Temps qui s'extasient sur le « renouveau des lettres romandes », alors qu'il l'annonçait depuis 30 ans, ce renouveau, et qu'elles n'ont rien vu venir (et pour cause, elles ignoraient ses livres), il doit sourire, entouré de ses popes aux longues barbes, de tous ces brusques revirements, lui qui a enduré insultes, mépris et silences gênés, il a fallu qu'il meure pour qu'on ose à nouveau prononcer son nom : Dimitri.