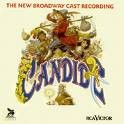 Comment va le monde? Qui le dirige? Comment survivre au milieu des mensonges et des crimes?
Comment va le monde? Qui le dirige? Comment survivre au milieu des mensonges et des crimes?
Pour répondre à ces questions, il faut relire Candide, le conte philosophique que Voltaire, l'homme aux 200 pseudonymes, publia en 1758. Si l'on veut comprendre le monde contemporain, rien n'est plus édifiant : les guerres absurdes, l'injustice, l'exploitation de l'homme par l'homme (et de la femme par l'homme), les rêves utopiques, etc. Remplacez le fameux « optimisme » prêché par Pangloss, le philosophe borgne, par « mondialisation » ou « libéralisme », et vous aurez tout compris. Après Rousseau, mais avant tous les autres, Voltaire avait mis le doigt sur les défauts du système, et les mensonges qui cherchent à les dissimuler.
On peut voir actuellement, au Théâtre de Carouge, une adaptation de Candide, écrite par l'écrivain genevois Yves Laplace et mise en scène par Hervé Loichemol. Même si le résultat n'est pas très convainquant (texte plat et mise en scène ampoulée), la pièce trop longue et la distribution extrêmement inégale, Candide est toujours d'actualité parce qu'il dénonce les machinations idéologiques qui essaient de nous aliéner.
L'une d'elles s'appelle le WEF, ou World Economic Forum. Elle se tient à Davos depuis près de trente ans et ressemble tout ce que le monde compte de « puissants » et de « décideurs ». Tout ce petit monde devise, plus ou moins poliment, autour d'une tasse de thé, des problèmes des autres. Cette année, c'est la crise financière, que tous ces hommes et ces femmes doués de pouvoirs extralucides n'ont bien sûr pas vu venir (mais qu'ils ont certainement contribué à provoquer). À quoi servent-ils? demanderait Voltaire. À rien. Quel sens donner à leurs discours, si semblables aux longues péroraisons de Pangloss, docteur en métaphysico-nigologie? Aucun, bien sûr. Alors pourquoi se réunissent-ils ainsi chaque année? Voltaire dirait sans doute qu'il s'agit d'une sorte de thérapie collective : les puissants se réunissent pour oublier leurs crimes (la Géorgie, la bande de Gaza) et sceller leur alliance. Qu'une meute hurlante de journalistes les accompagne chaque jour ne change rien à l'affaire. Ils peuvent dire n'importe quoi (ils ne s'en privent pas d'ailleurs) puisque leurs paroles, répercutées dans le monde entier, n'ont aucun poids, aucune incidence sur le monde réel, comme les discours admirablement vides du docteur Pangloss…
Oui, pour comprendre l'imposture du monde actuel, relisez Candide — et Le Monde comme il va, et Micromégas et L'Ingénu ! Relisez aussi La Plaisanterie de Milan Kundera. Et La Tache de Philip Roth. Si les hommes politiques lisaient davantage de littérature, ils n'auraient pas besoin d'aller faire de la figuration dans les neiges davosiennes.
 Auteur de sept romans remarqués (dont le remarquable Les Larmes de ma mère*, Prix Dentan 2004), Michel Layaz (né en 1963 à Fribourg) fait partie, sans conteste, de la jeune garde des Lettres romandes. On peut classer ses livres selon leur ton et leur propos : il y a, d’une part, les textes d’une veine intimiste, comme Les Larmes de ma mère, et les textes d’apparence plus légère, mais tout aussi intéressants, d’une veine drolatique et satiriste, comme La Complainte de l’idiot.
Auteur de sept romans remarqués (dont le remarquable Les Larmes de ma mère*, Prix Dentan 2004), Michel Layaz (né en 1963 à Fribourg) fait partie, sans conteste, de la jeune garde des Lettres romandes. On peut classer ses livres selon leur ton et leur propos : il y a, d’une part, les textes d’une veine intimiste, comme Les Larmes de ma mère, et les textes d’apparence plus légère, mais tout aussi intéressants, d’une veine drolatique et satiriste, comme La Complainte de l’idiot.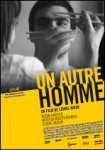 Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film.
Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film. Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).
Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).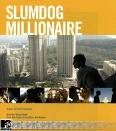 e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…
e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…