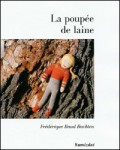 Il y a des livres qui nous hantent parce qu’ils sont justes, parce qu’ils touchent à l’essentiel de notre condition humaine. La Poupée de laine* de Frédérique Baud Bachten est de ceux-là. Avec cette première publication aux éditions Samizdat, l’auteure renoue avec son expérience du théâtre et de la radio. Elle évoque le tragique destin d’un enfant, né pas comme les autres, tourmenté par un mal sans nom, mettant en péril le fragile équilibre de ceux qui l’aiment avec une volonté peu commune. Doris Lessing avec le Cinquième Enfant **, Siri Hustvedt avec Tout ce que j’aimais***, et tout récemment, Jean-Louis Fournier avec Où on va, papa ? ****, ont abordé la douloureuse question de la filiation de la différence, une différence qui parfois peut s’apparenter au diable en personne. Doit-on se sentir coupable d’avoir engendré le pire ? Pourquoi le mal s’incarne-t-il dans un enfant, fruit de l’amour et du bonheur sans limite ? Suffit-il de comprendre l’héritage ambivalent que nous lèguent nos ancêtres, d’en analyser la part vénéneuse, afin de chasser la cruauté du destin ? La Poupée de laine est peut-être une tentative de réponse — les enfants ne nous appartiennent pas — mais aussi le récit d’une possibilité de pardon.
Il y a des livres qui nous hantent parce qu’ils sont justes, parce qu’ils touchent à l’essentiel de notre condition humaine. La Poupée de laine* de Frédérique Baud Bachten est de ceux-là. Avec cette première publication aux éditions Samizdat, l’auteure renoue avec son expérience du théâtre et de la radio. Elle évoque le tragique destin d’un enfant, né pas comme les autres, tourmenté par un mal sans nom, mettant en péril le fragile équilibre de ceux qui l’aiment avec une volonté peu commune. Doris Lessing avec le Cinquième Enfant **, Siri Hustvedt avec Tout ce que j’aimais***, et tout récemment, Jean-Louis Fournier avec Où on va, papa ? ****, ont abordé la douloureuse question de la filiation de la différence, une différence qui parfois peut s’apparenter au diable en personne. Doit-on se sentir coupable d’avoir engendré le pire ? Pourquoi le mal s’incarne-t-il dans un enfant, fruit de l’amour et du bonheur sans limite ? Suffit-il de comprendre l’héritage ambivalent que nous lèguent nos ancêtres, d’en analyser la part vénéneuse, afin de chasser la cruauté du destin ? La Poupée de laine est peut-être une tentative de réponse — les enfants ne nous appartiennent pas — mais aussi le récit d’une possibilité de pardon.Le récit débute sur la scène d’un théâtre planté au cœur des vignes. Y figure une comédienne, à la fois auteure et héroïne de l’histoire, répétant son texte en tenant dans ses mains, pour seul accessoire, une poupée de laine tricotée par sa mère, trouée au ventre, qui sent la naphtaline et les odeurs de son enfance. De ce premier texte dont nous ne connaîtrons que le début indiqué par des italiques, nous devinons qu’il est né de la souffrance à l’état brut et de la haine. C’était un cri qui soudainement a perdu son sens : « N’avoir que des mots c’est ne rien avoir pour dire un cri ! Leur grammaire, leurs significations diverses, toute leur ambiguïté l’écorche maintenant. ». Incapable d’affronter son public, la comédienne fuit le théâtre pour s’enfoncer dans la forêt et vivre une expérience étrange et fantastique qui inspirera une deuxième mouture du texte. C’est cette deuxième version qui prend forme peu à peu sous nos yeux, qui se déroule et se noue au fil d‘une narration, non pas linéaire, mais qui se cherche dans une obstinante fuite hors du drame, de la trame maternelle. Malgré les échappées au bord du gouffre, le fil ne rompt pas et la poupée de laine qui se défait au fur et à mesure que l’on tire sur la laine, sert alors de métaphore au texte qui se déforme et se recompose. À force de se hisser hors du gouffre, en tirant sur le fil des maux, la malédiction maternelle perd de sa puissance et se transforme en une pelote qui servira peut-être à autre chose. « Désormais, le ventre de laine est vide. Son contenu gît épars en guise d’humus au pied des grands arbres. Elle laisse à la forêt le soin d’en éroder le dernier vestige… Dans sa poche, le fil enroulé sur lui-même fait une bosse qu’elle caresse doucement comme un chagrin longtemps porté. »
Ce sont les éléments naturels, la terre, les feuilles mortes, la mousse qui, au cœur de la forêt, lui révèlent le secret douloureux de sa double nature. Si la terre est nourricière comme une mère, elle est aussi destructrice. C’est cette révélation qui la ravage, cette insoutenable ambivalence qui pulvérise toute espérance. Terre, mère, enfant : tout se confond dans la peine. Sa mère, tant aimée et admirée, l’a maudite deux fois, d’abord pour être née fille et non garçon et ensuite pour n’avoir pas su retenir son père, le déserteur. La malédiction aurait-elle ainsi gagné l’enfant fou ? Nul ne sait. Tous, médecins, infirmiers, assistants sociaux, tuteurs semblent impuissants devant le mal. Si la société ne peut contenir le désespoir qui les ronge, seul l’imaginaire collectif des contes et légendes peut encore rivaliser avec la tragédie qui se déroule sous leurs yeux. C’est ainsi que s’impose la figure de la fée Mélusine, elle-même fille maudite de la sorcière Pressine et mère d’un enfant fou. Figure tutélaire qui partage sa douleur et la sauvera de la mort.
* Baud Bachten, Frédérique. La Poupée de laine (Genève, Éditions Samizdat, liminaire de Lytta Basset, 2008), 78 p.
** Lessing, Doris. Le Cinquième Enfant (Paris, Albin Michel, 1990).
*** Hustvedt, Siri. Tout ce que j’aimais (Arles, Actes Sud, trad. de l’américain par Christine LeBœuf, 2003), 460 p.
**** Fournier, Jean-Louis. Où on va, papa ? (Paris, Éditions Stock, 2008), 155 p.
 La question n’est pas neuve, elle resurgit périodiquement au gré d’un instant de lucidité : que sont devenues les pages «livres» de nombreux quotidiens francophones ? A feuilleter des numéros de quinze ans d’âge, on mesure la profonde transformation en cours. Comme les archéologues, nous côtoyons un autre monde : les articles étaient longs et diversifiés, les photos n’occupaient qu’une faible partie de la page. Le choix des livres présentés était confié à des collaborateurs spécialisés, au nom reconnu dans le domaine. Les critiques littéraires disposaient d’un recul pour décrire des livres que l’actualité n’avait pas distingués. C’est que les articles littéraires se voulaient un commentaire de qualité, en vue d’informer le lecteur-citoyen et non un acte promotionnel destiné à flatter le consommateur. Depuis quelques années, les changements se sont précipités. L’écrivain Pierre Michon percevait cette tendance dès 1989 :«Le marché du livre n’a plus le besoin ni la patience de déguiser : à ce qu’il ne s’embarrasse même plus d’appeler art, il a substitué depuis longtemps la marchandise, sans tambour ni trompette.»
La question n’est pas neuve, elle resurgit périodiquement au gré d’un instant de lucidité : que sont devenues les pages «livres» de nombreux quotidiens francophones ? A feuilleter des numéros de quinze ans d’âge, on mesure la profonde transformation en cours. Comme les archéologues, nous côtoyons un autre monde : les articles étaient longs et diversifiés, les photos n’occupaient qu’une faible partie de la page. Le choix des livres présentés était confié à des collaborateurs spécialisés, au nom reconnu dans le domaine. Les critiques littéraires disposaient d’un recul pour décrire des livres que l’actualité n’avait pas distingués. C’est que les articles littéraires se voulaient un commentaire de qualité, en vue d’informer le lecteur-citoyen et non un acte promotionnel destiné à flatter le consommateur. Depuis quelques années, les changements se sont précipités. L’écrivain Pierre Michon percevait cette tendance dès 1989 :«Le marché du livre n’a plus le besoin ni la patience de déguiser : à ce qu’il ne s’embarrasse même plus d’appeler art, il a substitué depuis longtemps la marchandise, sans tambour ni trompette.»