Qu’est-ce qu’un écrivain ? Une voix, un style. Une présence. Mais aussi : un engagement, une vision singulière du monde. Une mémoire. Sans oublier, bien sûr, la fantaisie et un goût irrépressible pour la liberté.
 Toutes ces qualités, on les retrouve, brillantes comme un diamant, chez Mousse Boulanger. Faut-il encore présenter cette femme au destin extraordinaire, née à Boncourt en 1926, dans une famille nombreuse, et qui fut, tour à tour, journaliste, productrice à la radio, comédienne, écrivaine et poète ?
Toutes ces qualités, on les retrouve, brillantes comme un diamant, chez Mousse Boulanger. Faut-il encore présenter cette femme au destin extraordinaire, née à Boncourt en 1926, dans une famille nombreuse, et qui fut, tour à tour, journaliste, productrice à la radio, comédienne, écrivaine et poète ?
Une voix, disais-je, une présence immédiate. La vibration de l’émotion poétique.
À l’époque où elle travaillait à la radio romande, Mousse Boulanger a interrogé des dizaines d’écrivains, suisses et français, sur leur relation à la langue, leur credo, leur engagement. À ce travail journalistique s’est ajoutée, depuis toujours, la passion de la poésie. Cette passion qu’elle a vécue et partagée avec son mari, Pierre Boulanger, journaliste et poète, lui aussi, et qu’elle a diffusée, des années durant, dans des récitals poétiques qui faisaient vibrer les villes et les villages.
Une voix, un regard malicieux, une présence.
Mousse Boulanger, qui fut l’amie de Gustave Roud et de Vio Martin, s’est beaucoup dévouée pour les autres. Elle a pourtant trouvé le temps d’écrire une trentaine de livres : essais, romans, nouvelles, poèmes. C’est dire si sa voix est riche et porte loin ! Cette œuvre, encore trop méconnue, est l’une des plus vivantes de Suisse romande. Il faut relire l’Écuelle des souvenirs, splendides poèmes de la mémoire, et son dernier polar, Du Sang à l’aube, modèle du genre policier.
 Ce mois-ci, Mousse Boulanger publie Les Frontalières*, un livre magnifique qui est à la lisière du récit et du poème. La lisière, les limites, la frontière : c’est la vie de la narratrice, petite fille toujours en vadrouille, qui passe gaillardement de Suisse en France, et vice versa, dans les années qui précèdent la Seconde guerre mondiale. L’herbe est toujours plus verte, bien sûr, de l’autre côté. Elle franchit la frontière à bicyclette, sans se préoccuper des gros nuages noirs qui envahissent le ciel. À travers ses souvenirs d’enfance, Mousse Boulanger ravive la mémoire d’une époque, d’un village, d’une famille. Elle brosse le portrait émouvant d’une mère éprise de liberté qui ne comprend pas toujours ses enfants.
Ce mois-ci, Mousse Boulanger publie Les Frontalières*, un livre magnifique qui est à la lisière du récit et du poème. La lisière, les limites, la frontière : c’est la vie de la narratrice, petite fille toujours en vadrouille, qui passe gaillardement de Suisse en France, et vice versa, dans les années qui précèdent la Seconde guerre mondiale. L’herbe est toujours plus verte, bien sûr, de l’autre côté. Elle franchit la frontière à bicyclette, sans se préoccuper des gros nuages noirs qui envahissent le ciel. À travers ses souvenirs d’enfance, Mousse Boulanger ravive la mémoire d’une époque, d’un village, d’une famille. Elle brosse le portrait émouvant d’une mère éprise de liberté qui ne comprend pas toujours ses enfants.
« Allez, courage, dans dix minutes, on est à la maison ! »
La seule maison qui compte, pour la fillette de douze ans qui a la bougeotte, c’est l’amour, la liberté, la poésie…
Il faut lire ce récit haletant, écrit dans une langue vive, rapide, qui sait aller à l’essentiel. Il nous incite à franchir les frontières, plus ou moins imaginaires, qui limitent nos vies. Les interdits stupides. Les conventions. Nous sommes tous des frontaliers, déchirés entre deux pays. La patrie de nos pères et le royaume allègre et tendre de nos mères.
* Mousse Boulanger, Les Frontalières, L’Âge d’Homme, 2013.
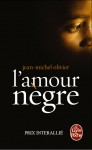 Une belle couverture vaut mieux qu'un long discours : après le succès de l'édition originale (4 rééditions et près de 60'000 exemplaires vendus), voici L'Amour nègre (Prix Interallié 2010) publié en Livre de Poche.
Une belle couverture vaut mieux qu'un long discours : après le succès de l'édition originale (4 rééditions et près de 60'000 exemplaires vendus), voici L'Amour nègre (Prix Interallié 2010) publié en Livre de Poche. Pour les gens de ma génération, Muriel Cerf fut à la fois un modèle et un éblouissement. Un modèle, tout d'abord, parce que, née en 1950, elle est l'une des premières à prendre la route, à 17 ans, sur la trace des hippies, pour le fameux périple des trois K (Kaboul, Katmandou et Kuta). Voyage initiatique dont elle rapportera, un peu plus tard, deux livres extraordinaires : L'Antivoyage (1974) et Le Diable vert (1975), qui ont marqué une génération de voyageurs et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier). Muriel Cerf nous a montrés les chemins de la liberté, quelquefois décevante ou illusoire, et la richesse du voyage.
Pour les gens de ma génération, Muriel Cerf fut à la fois un modèle et un éblouissement. Un modèle, tout d'abord, parce que, née en 1950, elle est l'une des premières à prendre la route, à 17 ans, sur la trace des hippies, pour le fameux périple des trois K (Kaboul, Katmandou et Kuta). Voyage initiatique dont elle rapportera, un peu plus tard, deux livres extraordinaires : L'Antivoyage (1974) et Le Diable vert (1975), qui ont marqué une génération de voyageurs et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier). Muriel Cerf nous a montrés les chemins de la liberté, quelquefois décevante ou illusoire, et la richesse du voyage.  Éblouissement, ensuite, d'un style unique dans la littérature française : ni relation de voyage au sens strict, ni récit purement imaginaire, ces deux livres nous proposent un tableau sensuel des impressions laissées par les lieux, les personnes, les événements rencontrés. L'écriture, déjà saluée par Malraux en 1974, est flamboyante, pleine de couleurs, d'odeurs, de saveurs insolites. Un éblouissement.
Éblouissement, ensuite, d'un style unique dans la littérature française : ni relation de voyage au sens strict, ni récit purement imaginaire, ces deux livres nous proposent un tableau sensuel des impressions laissées par les lieux, les personnes, les événements rencontrés. L'écriture, déjà saluée par Malraux en 1974, est flamboyante, pleine de couleurs, d'odeurs, de saveurs insolites. Un éblouissement. Muriel Cerf est décédée d'un cancer au mois d'avril 2012. Aucun journal, en Suisse, n'en a parlé. Injustice scandaleuse, mais qui n'étonne personne, quand on connaît la presse de ce pays. Pourtant, elle a donné à la littérature française ses plus belles pages et incité de nombreux écrivains à partir sur ses traces. Elle a publié une trentaine de livres, essais et romans. Parmi les plus connus, citons Une passion (1981), hommage à Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou encore Ils ont tué Vénus Ladouceur (éditions du Rocher, 2000).
Muriel Cerf est décédée d'un cancer au mois d'avril 2012. Aucun journal, en Suisse, n'en a parlé. Injustice scandaleuse, mais qui n'étonne personne, quand on connaît la presse de ce pays. Pourtant, elle a donné à la littérature française ses plus belles pages et incité de nombreux écrivains à partir sur ses traces. Elle a publié une trentaine de livres, essais et romans. Parmi les plus connus, citons Une passion (1981), hommage à Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou encore Ils ont tué Vénus Ladouceur (éditions du Rocher, 2000). Les Himalayas, on les sent près, sans les voir. L'air de la nuit nous saoule de bouffées d'herbe humide. Les temples luisent sous la lune, recourbent les pointes dorées de leurs triples étages au milieu d'une mer de tuiles. De Katmandou, on ne distingue que le forme des toits qui lui donne déjà l'aspect d'une vraie cité asiatique, aussi différente des cités indiennes que des villes géantes d'Amérique. On respire l'haleine qui monte du fleuve proche, les parfums de santal brûlé dans les rues, le souffle glacé de la montagne, en écoutant les cloches des temples, les klaxons des voitures, les tintements des bicyclettes, imaginant le théâtre grouillant derrière les rideaux de la nuit; allongées sur la terrasse dans le châle de Coulino, ouvrant des yeux énormes, cherchant à deviner ce qui se passe en bas, on prend le pouls de cette ville nouvelle, on résiste à l'envie que l'on a d'y plonger, on préfère l'écouter, la respirer, la rêver, la plus belle la plus inquiétante, la plus légendaire, le décor le plus fou pour des dieux déguisés en hommes, de toute une mythologie vivante. Le taureau de Nandin doit crotter sur la place du marché, Krishna faire du marché noir, Jésus et Judas se balader dans les sentiers en robe blanche, le meilleur haschisch du monde pousser dans des pots, banal comme un géranium en France. Coulino, on en plantera un dans le jardin de notre maison, on le laissera grandir jusqu'au ciel et on grimpera dessus pour atteindre le sommet de L'Himalchuli et y planter un drapeau noir. Coulino ?
Les Himalayas, on les sent près, sans les voir. L'air de la nuit nous saoule de bouffées d'herbe humide. Les temples luisent sous la lune, recourbent les pointes dorées de leurs triples étages au milieu d'une mer de tuiles. De Katmandou, on ne distingue que le forme des toits qui lui donne déjà l'aspect d'une vraie cité asiatique, aussi différente des cités indiennes que des villes géantes d'Amérique. On respire l'haleine qui monte du fleuve proche, les parfums de santal brûlé dans les rues, le souffle glacé de la montagne, en écoutant les cloches des temples, les klaxons des voitures, les tintements des bicyclettes, imaginant le théâtre grouillant derrière les rideaux de la nuit; allongées sur la terrasse dans le châle de Coulino, ouvrant des yeux énormes, cherchant à deviner ce qui se passe en bas, on prend le pouls de cette ville nouvelle, on résiste à l'envie que l'on a d'y plonger, on préfère l'écouter, la respirer, la rêver, la plus belle la plus inquiétante, la plus légendaire, le décor le plus fou pour des dieux déguisés en hommes, de toute une mythologie vivante. Le taureau de Nandin doit crotter sur la place du marché, Krishna faire du marché noir, Jésus et Judas se balader dans les sentiers en robe blanche, le meilleur haschisch du monde pousser dans des pots, banal comme un géranium en France. Coulino, on en plantera un dans le jardin de notre maison, on le laissera grandir jusqu'au ciel et on grimpera dessus pour atteindre le sommet de L'Himalchuli et y planter un drapeau noir. Coulino ?