 L'avantage des écrivains, c'est de vivre leur vie à l'endroit et à l'envers, comme Benjamin Button (voir chronique précédente), ici et ailleurs, autrefois et maintenant. En même temps. Philippe Sollers nous le rappelle dans son dernier roman, Les voyageurs du temps*. Par l'écriture, mais aussi la lecture, nous faisons l'expérience d'un temps sans limites. Nous voyageons avec Montaigne dans les campagnes bordelaises, nous pleurons avec lui la mort de ses enfants, nous passons de Virgile à Houellebecq, de Quignard à Pline le Jeune, de Racine à Chiacchiari, de Laclos à Sagan, de Duras à Melville, de Dostoïevski à Haldas… Nous parcourons le temps dans tous les sens, à notre rythme et selon notre bon plaisir. Nous avons vécu l'avenir (pas si radieux que ça. au fond) et nous vivrons notre passé, qui est toujours à découvrir.
L'avantage des écrivains, c'est de vivre leur vie à l'endroit et à l'envers, comme Benjamin Button (voir chronique précédente), ici et ailleurs, autrefois et maintenant. En même temps. Philippe Sollers nous le rappelle dans son dernier roman, Les voyageurs du temps*. Par l'écriture, mais aussi la lecture, nous faisons l'expérience d'un temps sans limites. Nous voyageons avec Montaigne dans les campagnes bordelaises, nous pleurons avec lui la mort de ses enfants, nous passons de Virgile à Houellebecq, de Quignard à Pline le Jeune, de Racine à Chiacchiari, de Laclos à Sagan, de Duras à Melville, de Dostoïevski à Haldas… Nous parcourons le temps dans tous les sens, à notre rythme et selon notre bon plaisir. Nous avons vécu l'avenir (pas si radieux que ça. au fond) et nous vivrons notre passé, qui est toujours à découvrir.
Comme Benjamin Button, je suis venu au monde comme un vieillard, riche de toutes les expériences, et je mourrai comme un nouveau-né, aussi naïf et ingénu qu'au premier jour…
Il y a, dans la lecture, une expérience proprement paradisiaque: nous pouvons retrouver, à notre guise, tous les visages que nous avons aimés, et qui sont là, à portée de la main, dans ces petits volumes de papier qu'on peut souvent glisser dans notre poche. Au coin d'une rue, à Paris, mais aussi à Lisbonne ou à Lausanne, à Londres ou à New York, Sollers fait des rencontres surprenantes. Il n'est jamais dépaysé : ce sont des connaissances de longue date. Mais quel bonheur de rencontrer Rimbaud, à 17 ans, alors qu'il invente les plus beaux poèmes de la langue française. Ou Isidore Ducasse, dit le Comte de Lautréamont, qui s'isole dans son alcôve pour scander les strophes des Chants de Maldoror! Et Pessoa, qui se confond avec son ombre, sur cette petite place de Lisbonne embaumée de grands acacias en fleurs… Et Casanova, figure tutélaire de Sollers, qui saute dans une gondole pour s'enfuir de Venise…
Il faut lire ce faux roman, sans intrigue ni suspense, comme une magnifique promenade littéraire à travers les lieux et les époques, les visages, les siècles, les grandes ombres du passé. La promenade n'est pas finie. Elle se poursuit de livre en livre, toujours à inventer. Comme il n'a pas de commencement, le temps n'a pas de fin non plus. À nous de l'explorer à notre guise…
Oui, faisons la fête à tous ces voyageurs, promeneurs immobiles, solitaires, insatiables chercheurs de l'or du temps…
* Philippe Sollers, Les voyageurs du temps, roman, Gallimard, 2008.
 Comme l'ornithorynque ou le panda, l'Intellectuel Français (ou I.F. pour reprendre le sigle inventé par Régis Debray dans un livre passionnant*) est une espèce en voie de disparition. Héritier lointain de l'Intellectuel Originel (ou I.O.), dont les plus fameux spécimens s'illustrèrent lors de l'affaire Dreyfus, l'I.F. voit aujourd'hui sa fin venir, supplanté par l'I.T. (ou Intellectuel Terminal) qui ne pense plus en terme en droit ou d'éthique, mais exprime ses humeurs au jour le jour — de préférence dans les pages “ Débats ” de Libération ou du Monde — dans l'espoir d'en tirer un bénéfice médiatique immédiat, et d'occuper la scène intellectuelle.
Comme l'ornithorynque ou le panda, l'Intellectuel Français (ou I.F. pour reprendre le sigle inventé par Régis Debray dans un livre passionnant*) est une espèce en voie de disparition. Héritier lointain de l'Intellectuel Originel (ou I.O.), dont les plus fameux spécimens s'illustrèrent lors de l'affaire Dreyfus, l'I.F. voit aujourd'hui sa fin venir, supplanté par l'I.T. (ou Intellectuel Terminal) qui ne pense plus en terme en droit ou d'éthique, mais exprime ses humeurs au jour le jour — de préférence dans les pages “ Débats ” de Libération ou du Monde — dans l'espoir d'en tirer un bénéfice médiatique immédiat, et d'occuper la scène intellectuelle. Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film.
Il y a quatre sortes de critiques. La plus difficile, sans conteste, est la critique littéraire: il faut se plonger dans l'univers d'un auteur, souvent contemporain, trouver ses marques dans un livre qui est une création, et n'a donc aucun équivalent, connaître la vie et l'œuvre de l'auteur, etc. Un cran en-dessous se situe la critique de musique et d'opéra: il s'agit, pour le (ou la) critique, de bien connaître le répertoire et de maîtriser tout un bagage technique (mise en scène, distribution, interprétation) qu'on met longtemps à acquérir. Beaucoup plus facile, en revanche, est la critique de théâtre:il faut certes avoir quelques notions de mise en scène, connaître les comédiens, mais pour cela il y a le dossier de presse. qui suffit largement. La forme la plus facile de critique est la critique de cinéma: il suffit d'un bagage plus ou moins conséquent (tous les films que l'on a déjà vus), de lire Voici ou Les Cahiers du cinéma, et de recopier fidèlement le dossier de presse du film. Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).
Dans ce cas, la critique ne fait que passer les plats, c'est-à-dire obéir aux diktats de la promotion : interviews pseudo-exclusives des stars du film, reportages sur la vie du couple Mendes-Winslet (mariés au civil), etc. Aucune distance, aucune perspective, aucune réflexion. Et quand, victime de cette campagne de propagande, vous allez voir le nouveau « chef-d'œuvre incontournable », vous vous surprenez à vous ennuyer ferme pendant plus de deux heures. Un scénario plat comme une omelette, des comédiens qui ne semblent pas concernés (la palme à Kate Winslet, jamais aussi mal dirigée), un esthétisme désuet et ridicule : en un mot, un film tape-à-l'œil sans profondeur, ni raison d'être. Mais peu importe le résultat: le succès est garanti par la promotion et les critiques (tous dithyrambiques, bien sûr : on adule, on adore, on se pâme…).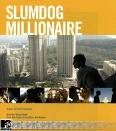 e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…
e homme issu des bidonvilles de Bombay qui, puisant dans sa mémoire et ses expériences, devient un jour millionnaire grâce à un jeu télévisé. C'est vif, plein de couleurs et d'odeurs incroyables (pas toujours agréables!), filmé au cordeau, époustouflant d'intelligence et d'imagination. Contrairement au film de Sam Mendes, pendant Slumdog millionnaire, on rit, on pleure, on a est révolté, on assiste avec effroi et bonheur à l'ascension du héros, prêt, finalement, à abandonner sa fortune pour retrouver la jeune femme qu'il aime, et qu'il poursuit pendant tout le film. Verdict des critiques : « film à éviter », « film à l'idéologie douteuse ». Une étoile dans Le Temps. Pouah! Encore un film populaire…