
Du mythique voyage vers l’Orient entrepris en 1953 par deux Genevois intrépides et rebelles, on n’avait que le témoignage de l’un d’entre eux : l’extraordinaire Usage du monde de Nicolas Bouvier, devenu la bible des routards et des globe-trotters. Aujourd’hui, on découvre l’autre visage de ce périple, grâce à Thierry Vernet, peintre, mais aussi écrivain, compagnon de route de Bouvier. C’est un éblouissement*.
Un volume imposant, tout d’abord, plus de sept cents pages, illustré de dessins magnifiques, dans lequel on se lance comme dans un voyage au long cours. Des lettres envoyées à ses proches, restés en Suisse, qui sont parfois de véritables romans, alternant les descriptions de lieux, de visages, de musiques, et les instantanés de la vie quotidienne du routard : les rencontres, les incidents, les surprises, les découvertes. Quand Vernet entreprend son périple, il a vingt-six ans, laisse à Genève une fiancée prénommée Fioristella (elle-même peintre de talent) et voyage seul. C’est à Belgrade, en juillet 1953, qu’un ami genevois le rejoindra, Nicolas Bouvier, surnommé Nick. Ensemble, ils vont entreprendre un grand voyage qui les mènera jusqu’à Ceylan, à bord de la fameuse Topolino. Là-bas, leurs routes se sépareront, Vernet rentrant en Suisse pour se marier et Bouvier poursuivant seul son périple vers le Japon. Du séjour à Ceylan, Bouvier rédigera, pendant plus de seize ans, dans la sueur et le whisky, le très beau Poisson Scorpion, véritable entreprise de désenvoûtement.
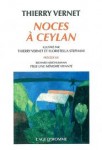 Mais Thierry Vernet ? Souvent dans l’ombre de Bouvier, qui s’est approprié ce voyage entrepris pourtant à deux, il se révèle un écrivain de la meilleure veine, multipliant les bonheurs d’expression et jouissant d’un don d’observation hors du commun. Dessinant, écrivant tous les jours (ses croquis étonnants ont illustré L’Usage du monde), il garde en toutes circonstances — à la différence de son compagnon cyclothymique — un moral d’acier. Son mot d’ordre est toujours le même : « sortir de soi-même ». Il l’appliquera jusqu’au terme du voyage, ornant ses lettres de dessins ou d’aquarelles qui en font de véritables œuvres d’art.
Mais Thierry Vernet ? Souvent dans l’ombre de Bouvier, qui s’est approprié ce voyage entrepris pourtant à deux, il se révèle un écrivain de la meilleure veine, multipliant les bonheurs d’expression et jouissant d’un don d’observation hors du commun. Dessinant, écrivant tous les jours (ses croquis étonnants ont illustré L’Usage du monde), il garde en toutes circonstances — à la différence de son compagnon cyclothymique — un moral d’acier. Son mot d’ordre est toujours le même : « sortir de soi-même ». Il l’appliquera jusqu’au terme du voyage, ornant ses lettres de dessins ou d’aquarelles qui en font de véritables œuvres d’art.
Un second volet de l’œuvre écrite de Vernet est aujourd’hui disponible, à l’Âge d’Homme, sous le beau titre de Noces à Ceylan.** On connaît les péripéties qui ont mené l’auteur du Poisson-Scorpion sur l’île maléfique de Ceylan. Son ami Thierry doit le rejoindre, mais il tarde un peu. Il a une bonne raison pour cela : il vient d’épouser sa fiancée, Fioristella Stephani. C’est précisément cet épisode que Vernet raconte, par le texte et le dessin, dans cet ouvrage qui est le complément de Peindre, écrire, chemin faisant.
 Au voyage de Bouvier, dont L'Usage du monde donne un témoignage décanté et stylisé, les lettres de Thierry Vernet forment une sorte de contrepoint. Comme un autre regard, à la fois généreux et profus, étonné et radieux. Parallèlement aux lettres publiées par l'Âge d'Homme, paraît un magnifique ouvrage, aux éditions Somogy et Galerie Plexus***, qui rend justice (enfin !) au talent du peintre Vernet. Accompagnée d'une présentation subtile et fouillée, signée Jan Laurens Siesling, ce livre contient de nombreuses reproductions de portraits et de natures mortes, réellement exceptionnells. Un ouvrage indispensable pour mieux connaître ce Genevois discret, mais intrépide et épris d'absolu, qui est décédé d'un cancer en octobre 1993.
Au voyage de Bouvier, dont L'Usage du monde donne un témoignage décanté et stylisé, les lettres de Thierry Vernet forment une sorte de contrepoint. Comme un autre regard, à la fois généreux et profus, étonné et radieux. Parallèlement aux lettres publiées par l'Âge d'Homme, paraît un magnifique ouvrage, aux éditions Somogy et Galerie Plexus***, qui rend justice (enfin !) au talent du peintre Vernet. Accompagnée d'une présentation subtile et fouillée, signée Jan Laurens Siesling, ce livre contient de nombreuses reproductions de portraits et de natures mortes, réellement exceptionnells. Un ouvrage indispensable pour mieux connaître ce Genevois discret, mais intrépide et épris d'absolu, qui est décédé d'un cancer en octobre 1993.
* Peindre, écrire chemin faisant par Thierry Vernet, illustré de nombreux dessins, introduction de Richard Aeschlimann et texte de Nicolas Bouvier, L’Âge d’Homme, 708 pages, 2006.
** Thierry Vernet, Noces à Ceylan, l'Âge d'Homme, 2010.
*** Thierry Vernet, peintre, par Jan Laurens Siesling, éditions Somogy et Galerie Plexus, Paris et Chexbres, 2006.
 Anne-Sylvie Sprenger (née à Lausanne en 1977) aime les livres brefs et intenses. En général une centaine de pages. Chapitres courts, aérés, où l'écriture cherche à décrire une blessure essentielle. Souvent inavouable. Toujours secrète. C'était le cas de Vorace, son premier livre, paru en 2007, porté sur les fonts baptismaux par Jacques Chessex, et loué par la critique française. Ça l'était également pour Sale fille, paru il y a deux ans. Le tout nouveau roman d'Anne-Sylvie Sprenger pourrait d'ailleurs s'appeler Sale type, tant il s'inscrit dans la continuité des précédents. Mais il s'appelle La Veuve du Christ*. Titre à la fois lumineux et provocateur.
Anne-Sylvie Sprenger (née à Lausanne en 1977) aime les livres brefs et intenses. En général une centaine de pages. Chapitres courts, aérés, où l'écriture cherche à décrire une blessure essentielle. Souvent inavouable. Toujours secrète. C'était le cas de Vorace, son premier livre, paru en 2007, porté sur les fonts baptismaux par Jacques Chessex, et loué par la critique française. Ça l'était également pour Sale fille, paru il y a deux ans. Le tout nouveau roman d'Anne-Sylvie Sprenger pourrait d'ailleurs s'appeler Sale type, tant il s'inscrit dans la continuité des précédents. Mais il s'appelle La Veuve du Christ*. Titre à la fois lumineux et provocateur.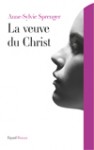 Et la victime ? « Lena a appris à vivre dans sa tête ». Elle se protège comme elle peut de la présence du monstre. Un monstre qui a cinquante ans, mais qui, affectivement, est fruste et malheureux. Ce qui n'est certes pas une excuse. Mais explique l'étrange relation qui va s'instaurer entre le bourreau et sa victime. La tendresse. Les caresses. Puis l'amour monstre. « Victor et Lena s'aimeront tout l'été. » Il y a quelque chose d'à la fois pathétique et troublant dans cette relation (on n'ose pas parler d'amour) qui transgresse les normes et les interdits. Certains évoqueront le
Et la victime ? « Lena a appris à vivre dans sa tête ». Elle se protège comme elle peut de la présence du monstre. Un monstre qui a cinquante ans, mais qui, affectivement, est fruste et malheureux. Ce qui n'est certes pas une excuse. Mais explique l'étrange relation qui va s'instaurer entre le bourreau et sa victime. La tendresse. Les caresses. Puis l'amour monstre. « Victor et Lena s'aimeront tout l'été. » Il y a quelque chose d'à la fois pathétique et troublant dans cette relation (on n'ose pas parler d'amour) qui transgresse les normes et les interdits. Certains évoqueront le  Paul Auster (né en 1947 dans le New Jersey) est un maître du roman. On se souvient de ses débuts flamboyants avec la fameuse trilogie new-yorkaise (La Cité de verre ; Les Revenants ; La Chambre dérobée*). Puis des romans souvent vertigineux, comme Moon Palace (1990) et surtout Léviathan (Prix Médicis étranger en 1993). Suit une époque où Auster, abandonnant la littérature, se lance dans le cinéma, réalisant d'honnêtes films d'ambiance (Smoke, avec Harvey Keitel). Après cette parenthèse cinématographique, le ténébreux auteur revient à la littérature, mais avec passablement de peine (pour ses admirateurs comme pour lui-même, semble-t-il). Depuis dix ans, les romans se suivent, inégaux, ampoulés, peu enthousiasmants.
Paul Auster (né en 1947 dans le New Jersey) est un maître du roman. On se souvient de ses débuts flamboyants avec la fameuse trilogie new-yorkaise (La Cité de verre ; Les Revenants ; La Chambre dérobée*). Puis des romans souvent vertigineux, comme Moon Palace (1990) et surtout Léviathan (Prix Médicis étranger en 1993). Suit une époque où Auster, abandonnant la littérature, se lance dans le cinéma, réalisant d'honnêtes films d'ambiance (Smoke, avec Harvey Keitel). Après cette parenthèse cinématographique, le ténébreux auteur revient à la littérature, mais avec passablement de peine (pour ses admirateurs comme pour lui-même, semble-t-il). Depuis dix ans, les romans se suivent, inégaux, ampoulés, peu enthousiasmants.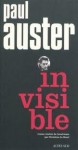 Comme on le voit, les récits s'emboîtent les uns dans les autres. Un vertige délicieux guette le lecteur impatient de savoir le fin mot du roman. La vérité du récit est sans cesse malmenée, questionnée, remise en cause. Qui dit la vérité ? Adam Walker qui raconte sa relation particulière avec sa sœur ? Gwyn, cette sœur, qui nie tout en bloc ? Ou encore Cécile, la jeune fille amoureuse d'Adam quand il étudiait à Paris ?Ou Rudolf Born, faux professeur, mais sans doute vrai agent ssecret ?
Comme on le voit, les récits s'emboîtent les uns dans les autres. Un vertige délicieux guette le lecteur impatient de savoir le fin mot du roman. La vérité du récit est sans cesse malmenée, questionnée, remise en cause. Qui dit la vérité ? Adam Walker qui raconte sa relation particulière avec sa sœur ? Gwyn, cette sœur, qui nie tout en bloc ? Ou encore Cécile, la jeune fille amoureuse d'Adam quand il étudiait à Paris ?Ou Rudolf Born, faux professeur, mais sans doute vrai agent ssecret ?