 Écrivain et journaliste, Jean-Bernard Vuillème (né en 1950), vit à La Chaux-de-Fonds, mais il a beaucoup voyagé. Écrit entre Cernier, Paris et Berlin, Lucie*, paru en 1995 aux éditions Zoé, est un livre inclassable, comme la plupart de livres de Vuillème, mais intrigant et qui ne cesse de fasciner. Il vaut la peine de le relire — ne serait-ce que pour l'hymne qu'il chante à ce prénom magique — Lucie — qui hante le récit.
Écrivain et journaliste, Jean-Bernard Vuillème (né en 1950), vit à La Chaux-de-Fonds, mais il a beaucoup voyagé. Écrit entre Cernier, Paris et Berlin, Lucie*, paru en 1995 aux éditions Zoé, est un livre inclassable, comme la plupart de livres de Vuillème, mais intrigant et qui ne cesse de fasciner. Il vaut la peine de le relire — ne serait-ce que pour l'hymne qu'il chante à ce prénom magique — Lucie — qui hante le récit.
Récit ou roman ? L'écrivain Franz Schötz ne se pose pas la question. Étendue sur le canapé, lisant par-dessus son épaule, Lucie n'a qu'une demande : écris-moi. Qu'il faut entendre dans les deux sens du terme : écris-moi une histoire et écris-la pour moi. Mais Schötz tourne autour du pot : il est en mal d'inspiration, ou du moins de narration. Il aimerait répondre au désir de Lucie, qui lui demande de raconter une histoire, son histoire, leur histoire, mais cela ne vient pas. Il s'échine à décrire un verre de bière, sans y arriver vraiment. Les mots lui font défaut. Le langage le trahit.
Pourtant, des personnages naissent de sa plume, un peu perdus comme lui, ou abandonnés dans la nuit d'un tunnel. C'est d'abord ce touriste belge à qui un voleur facétieux dérobe ses papiers dès qu'il arrive à Paris. Sans identité et sans le sou, le « prétendu Blondiau » erre dans les rues de la capitale comme un mendiant sans domicile. Ensuite, il y aura Giacomo, un homme qui traverse à pieds le tunnel du Simplon pour rejoindre sa famille. Il marche dans le noir, sa lanterne à la main, en manquant se faire écraser par les convois qui passent à toute vitesse. Ces deux avatars de l'écrivain, l'homme sans identité et le marcheur dans la nuit, ne suffisent pas à Lucie qui en veut plus — non des histoires à dormir debout, mais une histoire vraie, la sienne, la leur, qui soit comme l'enfant qu'elle désire ardemment.
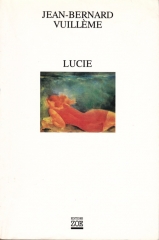 « Ainsi passais-je mes journées le cul sur une chaise installé dans l'infini virtuel de la littérature à ressasser ce qui fut, inventer ce qui pourrait être et supputer ce qui aurait pu advenir au point que j'en attrapais des fourmis dans les jambes (…) et finalement n'y tenant plus, je me précipitai dans la rue hors de moi-même, et peut-être au-devant de moi, prêt à tout et disposé à rien. »
« Ainsi passais-je mes journées le cul sur une chaise installé dans l'infini virtuel de la littérature à ressasser ce qui fut, inventer ce qui pourrait être et supputer ce qui aurait pu advenir au point que j'en attrapais des fourmis dans les jambes (…) et finalement n'y tenant plus, je me précipitai dans la rue hors de moi-même, et peut-être au-devant de moi, prêt à tout et disposé à rien. »
Avec l'écrivain Schötz, on pense aux personnages de Kafka ou de Robert Walser, perdus dans un monde dont ils ne connaissent pas (ou feignent d'ignorer) les règles et poursuivis par un destin d'autant plus impitoyable qu'il est aveugle.
À mesure que le récit progresse, la mystérieuse Lucie se détache du narrateur et l'on comprend alors que le livre qu'il essaie vainement d'écrire sera un livre de deuil et de séparation. « À la fin, je ne saurai plus. J'aurai perdu le goût de dire et je m'accrocherai comme une tique à mon propre sang. Ce livre pourrait être un livre qui se nourrit de son mal, ébauche d'histoires sans fin se reformant comme autant de croûtes successives sur une plaie grattée par habitude. J'enfilerai machinalement des mots sur les lignes tendues à travers les pages et des lambeaux de mémoire suspendus au fil de l'écriture sècheront au vent de l'amnésie. »
Lucie dicte sa loi, les battements du cœur de Schötz et le rythme de son livre. Mais à la fin elle se rebiffe : « Je ne veux plus être traitée comme un personnage, dit-elle. Ma vie n'est pas un roman. » Vuillème met admirablement en scène le dilemme éternel de l'écrivain : vivre ou écrire, il faut choisir ! En choisissant l'écriture – bribes de conversations, embryons d'histoires, morceaux de fiction, tranches de vécu — Schötz a perdu insensiblement Lucie qui se détache de lui et s'en va élever seule l'enfant qu'il lui a fait.
L'écriture dense et précise de Vuillème, son humour, sa fantaisie constante et sa tendresse, font de Lucie un livre qu'on n'oublie pas de sitôt. Autopsie d'un amour, projet d'un livre rêvé et avorté, incommunicabilité : il y a de tout cela dans ce texte à tiroirs, qui est aussi une réflexion saisissante sur le couple moderne.
* Jean-Bernard Vuillème, Lucie, éditions Zoé, 1995.





