 Les lecteurs romands connaissent bien Jérôme Meizoz : professeur de littérature à l’Université de Lausanne, auteur d’essais remarquables sur Ramuz, Lovay, Chappaz, Rousseau, et également de quelques récits brefs et percutants, comme Jours rouges (Editions d’En-Bas, 2003) ou Les Désemparés (Zoé, 2005). Dans Père et passe*, Meizoz ressuscite la figure de son père à travers des images, des éclats de voix et de rire, des cendres du passé : « La vie hurle et plante ses serres en nous, on se retourne pour voir d’ou est venu le coup : appeler ça des souvenirs. »
Les lecteurs romands connaissent bien Jérôme Meizoz : professeur de littérature à l’Université de Lausanne, auteur d’essais remarquables sur Ramuz, Lovay, Chappaz, Rousseau, et également de quelques récits brefs et percutants, comme Jours rouges (Editions d’En-Bas, 2003) ou Les Désemparés (Zoé, 2005). Dans Père et passe*, Meizoz ressuscite la figure de son père à travers des images, des éclats de voix et de rire, des cendres du passé : « La vie hurle et plante ses serres en nous, on se retourne pour voir d’ou est venu le coup : appeler ça des souvenirs. »À la manière d’un Pierre Michon ou d’un Pierre Bergounioux, Meizoz aime à ressusciter les « vies minuscules », les destins silencieux, dédaignés, oubliés. Lui qui, par ses études et sa passion, est le maître des mots, essaie de briser ce barrage de silence (et d’émotions) qui le sépare de son père, dont le souvenir est encore si vivace en lui. L’écriture de Meizoz, par petites touches de couleur, excelle à restituer l’univers de l’enfance dans un petit village valaisan qui est pour son père le centre du monde et « quand il en parle, ce lieu se tisse d’immensité ». Ce père « rouge » qui affiche le portrait de Karl Marx au salon et menace d’envoyer son fils à « Bümplitz » — suprême punition ! — s’il ne rapporte pas de bons résultats de l’école !
Si le livre de Meizoz cherche à ressusciter son père, pour se réconcilier avec lui, c’est aussi une sorte de transsubstantiation, « comme s’il fallait que père soit dématérialisé d’abord, démembré en chiffres et caractères, puis reconstitué en corps d’encre, pour me revenir enfin sous cette forme pérenne. » Par la magie des mots reste un portrait, en gestes et en éclats de voix, saisissant de tendresse et de vie, qui est un dernier pied de nez à la mort.
Père et passe de Jérôme Meizoz, Éditions d’en bas et Le Temps qu’il fait, 2008.
 Il faut goûter, à sa juste valeur, le regard malicieux et gourmand d'Esther Mamarbachi ou du solide Darius Rochebin quand, chaque soir, à l'heure de la grand-messe, ils évoquent, des trémolos dans la voix, les derniers rebondissements de l'affaire des « images à caractère pédophile » découvertes sur l'ordinateur d'un collaborateur de leur grande rivale : la RSR! Il faut goûter le souci du détail, l'absence de tout esprit critique et surtout cet air de sourde réprobation qui caractérise, parfois, nos Grandes-Têtes-Molles de la TSR…
Il faut goûter, à sa juste valeur, le regard malicieux et gourmand d'Esther Mamarbachi ou du solide Darius Rochebin quand, chaque soir, à l'heure de la grand-messe, ils évoquent, des trémolos dans la voix, les derniers rebondissements de l'affaire des « images à caractère pédophile » découvertes sur l'ordinateur d'un collaborateur de leur grande rivale : la RSR! Il faut goûter le souci du détail, l'absence de tout esprit critique et surtout cet air de sourde réprobation qui caractérise, parfois, nos Grandes-Têtes-Molles de la TSR…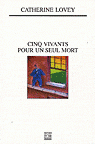 Née en 1967 en Valais, Catherine Lovey passe très tôt sa vie à lire et à écrire. Mais c’est un second choix ; elle voulait un piano et à la place elle reçoit une machine à écrire, orange et noire. Journaliste à La Tribune de Genève, puis à L’Hebdo, elle écrira alors dans de la rubrique économique, puis entreprend un postgrade en criminologie. Enfin, elle se décide à sortir de son armoire un manuscrit intitulé L’Homme interdit. Le texte est publié aux
Née en 1967 en Valais, Catherine Lovey passe très tôt sa vie à lire et à écrire. Mais c’est un second choix ; elle voulait un piano et à la place elle reçoit une machine à écrire, orange et noire. Journaliste à La Tribune de Genève, puis à L’Hebdo, elle écrira alors dans de la rubrique économique, puis entreprend un postgrade en criminologie. Enfin, elle se décide à sortir de son armoire un manuscrit intitulé L’Homme interdit. Le texte est publié aux