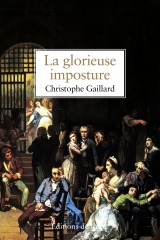Metin Arditi publie chez BSN, maison d'édition émergente et très intéressante, un recueil de trois nouvelles, destinées au théâtre ou à la radio. On retrouve les thèmes chers à cet écrivain prolifique qui convoque, ici, dans Freud, les démons*, ses fantômes familiers.
Metin Arditi publie chez BSN, maison d'édition émergente et très intéressante, un recueil de trois nouvelles, destinées au théâtre ou à la radio. On retrouve les thèmes chers à cet écrivain prolifique qui convoque, ici, dans Freud, les démons*, ses fantômes familiers.
Il y en a trois. D'abord, le grand Sigmund, qui donne son titre au recueil, saisi à la veille de sa mort, sur son lit de souffrance (un terrible cancer lui disloque la mâchoire). Shooté à la morphine, pour supporter la douleur, Freud évoque quelques figures importantes de sa vie et son amour secret pour une femme qui a fasciné plus d'un homme (Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Anatole France) :  Lou Andréas Salomé. Freud nourrit encore le regret de ne pas s'être déclaré, d'être passé à côté de l'amour, une fois de plus.
Lou Andréas Salomé. Freud nourrit encore le regret de ne pas s'être déclaré, d'être passé à côté de l'amour, une fois de plus.
 « Je me suis longtemps demandé si le propre des hommes n'est pas leur capacité à rater les occasions… Et même à les fuir, à grandes enjambées… Lorsqu'on se retourne sur sa vie, qu'on en tire un bilan, on devrait avoir le courage d'imaginer ce qu'elle aurait pu être. »
« Je me suis longtemps demandé si le propre des hommes n'est pas leur capacité à rater les occasions… Et même à les fuir, à grandes enjambées… Lorsqu'on se retourne sur sa vie, qu'on en tire un bilan, on devrait avoir le courage d'imaginer ce qu'elle aurait pu être. »
Dans cette évocation mélancolique, on pense à Irvin Yalom (Et Nietzsche a pleuré, Mensonges sur le divan) et à Roland Jaccard, auteur d'un roman-biographie de cette femme exceptionnelle (Lou). Le crime suprême, pour Arditi, c'est de ne pas oser. De ne pas avoir le courage d'aller au bout de son désir.
Le désir est présent, bien sûr, mais contrarié, mutilé, dans la deuxième nouvelle du recueil qui raconte le déclin d'un maestro, le grand chef d'orchestre Grégoire Karakoff qui, peu à peu, perd la mémoire et s'égare dans ses partitions. Dans cette nouvelle, Arditi, qui a bien connu le milieu musical, est très à l'aise pour décrire les avanies de l'âge (perte de mémoire, impuissance) et développe certains thèmes qu'il a traités dans d'autres livres. Son maestro est saisissant de vérité et touchant de sincérité.
Le troisième monologue, le plus court, met en scène le père de Vincent Van Gogh, Cornelius, au cours d'un repas qui sera le dernier partagé par la famille, puisqu'il marquera la fin des relations entre un père tyrannique qui ne comprend rien à la peinture et un fils génial qui ne comprend pas la haine de son père. Là encore, il aurait suffi d'oser, et d'un peu de courage pour que le père se rapproche de son fils et essaie de le comprendre, au lieu de l'exclure du cercle familial.
Trois monologues, écrits pour être dits, qui creusent les regrets, les remords, les impuissances de trois hommes en proie à leurs démons.
* Metin Arditi, Freud, les démons, BSN Press, 2021.