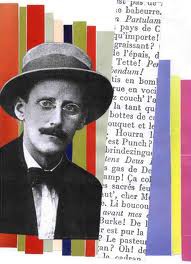Samedi dernier, sur le coup de 11 heures, a été remis, à la Fondation l'Estrée, à Ropraz, le Prix Édouard Rod 2013 à l'écrivain François Debluë pour l'ensemble ce son œuvre. Nous y étions....
Samedi dernier, sur le coup de 11 heures, a été remis, à la Fondation l'Estrée, à Ropraz, le Prix Édouard Rod 2013 à l'écrivain François Debluë pour l'ensemble ce son œuvre. Nous y étions....
L’écrivain que nous fêtons aujourd’hui n’est pas un inconnu — loin de là !
À son actif il a, comme on dit, une œuvre riche et diverse qui compte une vingtaine de romans, récits, recueils de poèmes ou proses poétiques. Une œuvre récompensée, déjà, par des prix prestigieux, comme le Prix Dentan, reçu en 1990, pour un récit intitulé Troubles Fêtes. Une œuvre qui explore constamment les confins de la musique et de la langue, représentée, peut-être, dans leur alchimie mystérieuse, par Les Saisons d’Arlevin, le livret qu’il écrivit pour la Fête des Vignerons de 1999.
 Tout commence, chez Debluë, par un étrange recueil de proses brèves, Lieux communs*, publié en 1979 à l’Âge d’Homme.
Tout commence, chez Debluë, par un étrange recueil de proses brèves, Lieux communs*, publié en 1979 à l’Âge d’Homme.
Étrange, parce que déchiré, déjà, en sa fibre même, coupé en deux parties. La première s’appelle Barbaries ; la seconde Conversions. Ce premier pli, cette déchirure intime n’avait pas échappé à Georges Haldas, qui écrivait ceci : « Dans le soporifique climat lémanien, je vois, à travers ces Lieux communs, comme perler les gouttes d’un sang noir. Montée d’une blessure intime, irrémédiable. Un amour, dès l’enfance, mutilé. »
D’où vient ce sang noir ? Et quelle est cette blessure intime ?
Debluë multiplie les indices, dès l’amorce du recueil :  « Parler donne soif. Simon n’échappe pas à cette fatalité. Vous le savez bien. Aussi guettez-vous ce mouvement vif et imperceptible de la langue qui viendra sans tarder étancher les lèvres sèches et pâteuses de Simon. Poursuivez plutôt votre chemin ! Car sa petite source est tarie. Depuis longtemps déjà ses adversaires lui ont coupé la langue. »
« Parler donne soif. Simon n’échappe pas à cette fatalité. Vous le savez bien. Aussi guettez-vous ce mouvement vif et imperceptible de la langue qui viendra sans tarder étancher les lèvres sèches et pâteuses de Simon. Poursuivez plutôt votre chemin ! Car sa petite source est tarie. Depuis longtemps déjà ses adversaires lui ont coupé la langue. »
Dans cet extrait, premier fragment du premier livre paru, tout est dit, semble-t-il. L’écrivain parle à partir d’une blessure. Ou plutôt il ne parle pas. Car on lui a coupé la langue. Il écrit donc dans le silence et étanche sa soif comme il peut, à la petite source, car parler donne soif.
Pour le père Simon, la petite source, hélas, est tarie. Mais pour François Debluë, heureusement, c’est à cette source de silence qu’il va puiser l’œuvre à venir, constamment travaillée par cette blessure, et par un désir de transparence.
Le second livre, toujours à l’enseigne du Rameau d’Or de Georges Haldas, s’appelle Faux jours. Il paraît en 1983.
Il explore, entre fable et poème, un pays plus autobiographique. Revisitant son passé, son présent et son hypothétique avenir, l’auteur chercher à confondre les mensonges, les petites impostures, les faux jours qui éclairent nos vies. La quête autobiographique a déjà commencé. Elle se fait par fragments, éclairs quelquefois aveuglants, instantanés quasi photographiques, saisis miraculeusement. James Joyce appelait cela des épiphanies. Il notait ces images dans de petits carnets qui alimentaient ses romans. Debluë aussi ausculte ces déchirures où se révèle une certaine vérité.
Lumière de la vérité. Pénombre du mensonge.
Toute l’œuvre de Debluë développe cette dialectique, beaucoup plus subtile qu’il n’y paraît. Car, on le sait, le mensonge est aussi source de vérité, et la lumière peut être trompeuse comme un faux jour. Seul compte, pour l’écrivain, le travail de la langue. Le monde n’est pas noir ou blanc. Pour dire sa vérité et sa complexité, il faut toute une palette de couleurs, et maîtriser le clair-obscur du langage.
La quête de soi-même passe par les poèmes de La Nuit venue ou du Travail du Temps. Elle déploie les Figures de la patience ou explore les Demeures de l’ombre — autant de titres transparents. Le poète se tient à la déchirure du jour, je l’ai dit. Mais aussi aux confins de la musique.
Il y a trois ans, François Debluë publiait à l’Âge d’Homme, un livre intitulé Fausses Notes, précisément, qui conjugue la musique au mensonge ou à la maladresse. Est-ce un roman ? Un récit ? Un recueil de poèmes ? Non. Debluë lui donne un sous-titre ironique : Minimes. Il s’agit de pensées brèves, d’aphorismes, de fusées, comme disait Baudelaire, où la réalité se révèle par éclairs, jaillissements, fragments arrachés au silence.
L’année dernière, François Debluë nous a donné trois livres, et non des moindres.
 Le récit d’un voyage en Chine, qui est aussi une réflexion sur l’hospitalité et le regard de l’autre. Un recueil de poèmes, Par ailleurs, qui suggère avec force que l’écriture est toujours incomplète, qu’il y a du reste — autrement dit de l’ailleurs – dans tous les livres. Car on écrit toujours par-dessus le marché. En supplément à la vie ordinaire.
Le récit d’un voyage en Chine, qui est aussi une réflexion sur l’hospitalité et le regard de l’autre. Un recueil de poèmes, Par ailleurs, qui suggère avec force que l’écriture est toujours incomplète, qu’il y a du reste — autrement dit de l’ailleurs – dans tous les livres. Car on écrit toujours par-dessus le marché. En supplément à la vie ordinaire.
L’ordinaire, c’est la fin de la boucle.
Retour à la source tarie. Retour aux lieux communs.
Dans son dernier roman, François Debluë continue à se peindre, à la troisième personne, sous les traits d’un homme parfaitement ordinaire. Il se prend pour un autre. Il multiplie les masques et les habits d’emprunt. Il se dessine en cuisinier, en paresseux, en frère vaisselier, en veuf, en homme ridicule.
Fausses notes ou lieux communs, ces fragments arrachés au silence forment une sorte de mosaïque où apparaît, finalement, la figure du poète. Par défaut, peut-être. Ou en filigrane. Mais on finit par reconnaître François Debluë dans le portrait de cet homme ordinaire, qui n’est pas si ordinaire que cela.
* La plupart des livres de François Debluë ont paru aux Éditions Empreintes (pour la poésie) et L'Âge d'Homme (pour les récits, proses et romans).