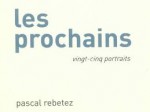On ne présente plus Michel Viala, auteur d'innombrables pièces de théâtre, comédien, metteur en scène et scénariste de télévision, qui vient de nous quitter. Il y a quelques années, il avait publié, sous le titre de Post-Sapiens, un roman d'anticipation apocalyptique, qui avait marqué la rentrée littéraire. Aujourd'hui, avec Jumeau*, repris dans la collection Poche Suisse, Viala noue donne un récit autobiographique qui a valeur de témoignage, et s'inscrit naturellement dans la suite de Post-Sapiens.
On ne présente plus Michel Viala, auteur d'innombrables pièces de théâtre, comédien, metteur en scène et scénariste de télévision, qui vient de nous quitter. Il y a quelques années, il avait publié, sous le titre de Post-Sapiens, un roman d'anticipation apocalyptique, qui avait marqué la rentrée littéraire. Aujourd'hui, avec Jumeau*, repris dans la collection Poche Suisse, Viala noue donne un récit autobiographique qui a valeur de témoignage, et s'inscrit naturellement dans la suite de Post-Sapiens.
C'est l'histoire (authentique) de deux frères nés le même jour, mais peut-être pas sous la même étoile. Tandis que l'un, par vocation, se lance dans le théâtre, avec la réussite que l'on connaît (tout le monde se souvient de la géniale Invitation de Goretta dont Viala fut le scénariste), l'autre, au fil des ans, sombre dans la déprime et le dégoût de soi, comme attiré, irrésistiblement, par la folie et par la mort.
Après un long silence, Michel le théâtreux retrouve Maurice l'insoumis, qui semble enfin sur la « bonne » voie : il est marié, vient d'avoir un enfant, et a enfin une place de travail. Mais cette stabilité, hélas, ne dure pas. Une fois de plus, sa destinée bascule dans l'horreur : Maurice, bien des années plus tard, assassine son propre fils, puis se donne la mort dans la clinique genevoise où on le soigne.
Entraînant l'autre — le double survivant — dans le désarroi et la solitude.
Texte écrit dans la fièvre, pour sauver du désastre la mémoire de l'autre, mais aussi sa propre mémoire, menacée par l'alcool et l'oubli, Jumeau a la force d'un exorcisme : comme Nicolas Bouvier, Viala joue de la magie blanche de l'écriture contre la magie noire du malheur, afin d'élucider sa propre vie, qui ressemble tellement à une tragédie antique, en s'abstenant, toutefois, de conclure, car l'espoir demeure, toujours, d'échapper aux traquenards du destin.
* Michel Viala, Jumeau, récit, Poche Suisse, l'Âge d'Homme, 2008.