

C'est grâce à un entrefilet du Temps que j'ai appris cette nouvelle stupéfiante: au Canada, dans la belle province du Québec, les téléspectateurs préfèrent regarder les séries (ou fictions) canadiennes plutôt que les séries américaines. Et ce à près de 70%! Pourquoi donc? D'abord parce qu'ils s'y retrouvent, qu'ils ont plaisir à entendre leur langue, à partager les soucis et les joies de leurs voisins-voisines. Ensuite, parce que ces séries pétillent d'imagination, d'humour, de personnages hauts en couleur.
Et nous, alors, me direz-vous, n'avons-nous pas sur la TSR La Minute-kiosque ? Et Tête en l'air?
Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette Minute-kiosque jusqu'au bout? C'est-à-dire 60 secondes? Moi pas. L'envie de zapper est venue tout de suite, puis celle de ne plus payer ma concession, puis celle de mettre le feu à ma télé. Quant à Tête en l'air, qui donne une idée de ce que peut être la télévision quand elle n'a rien à dire, par pudeur je n'en dirai rien.
Inutile d'insister: en matière de fiction ou de divertissement, la TV romande n'est pas franchement mauvaise : elle est nulle! Aucune série digne de ce nom. Aucune fiction qui ose aborder les questions qui nous occupent. Aucun téléfilm ambitieux ou personnel (et pourtant, les réalisateurs de talent ne manquent pas: Jacob Berger, Lionel Baier, Jean-Stéphane Bron, etc.). On dirait que du côté de la fiction, la Grande Tour est vide…
Victime, comme vous, chers lecteurs, de la propagande télévisuelle ânonée par TV Guide, TéléTop et autres brosses à reluire, je me suis laissé embarquer, l'autre soir, dans une série américaine au titre prometteur : Californication. D'abord parce qu'il y avait David Duchovny (le Mulder de X-Files), un comédien que j'aime beaucoup (diplômé de littérature à Yale tout de même!). Et ensuite parce que le héros est un écrivain, et rien que cela est stupéfiant!
Eh bien, courage, mes amis, éteignons notre poste! Rarement série américaine aura été aussi bâclée, mal filmée, mal jouée, mal scénarisée. Rien, dans cette histoire pleine de clichés, ne vaut le détour. Chaque épisode adopte le même schéma: désœuvrement de l'écrivain en mal d'inspiration, alcool ou autre substance euphorisante, partie de jambes en l'air avec femmes jeunes et topless, retour à la déprime. Je peux témoigner, en mon âme et conscience, que la vie d'écrivain, même en Californie, ne ressemble pas souvent à cela!
Bref, nous sommes à des lieues de ces chefs-d'œuvre absolus que sont Nip Tuck (qui va reprendre en avril) et surtout Six Feet Under.
Vous voyez : même quand il s'agit de choisir une série américaine, avec un comédien doué, notre télévision se met le doigt dans l'œil!

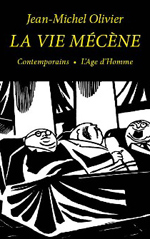 Quand on publie un livre, il y a toujours un risque qu'on le lise! C'est d'ailleurs ce qui peut lui arriver de mieux. Si certains critiques, par amertume ou désespoir, essaient d'abord d'éteindre le feu qui couve dans certains livres, d'autres, au contraire, prennent le risque de le lire, de s'en trouver choqués ou bouleversés, et peut-être brûlés par ce qu'ils lisent. C'est le cas de la critique empathique telle qu'elle est pratiquée, par exemple, par Jean-Louis Kuffer, Alain Bagnoud, Jean-François Fournier, Jacques Sterchi ou quelques autres, dont Contessa Pinon.
Quand on publie un livre, il y a toujours un risque qu'on le lise! C'est d'ailleurs ce qui peut lui arriver de mieux. Si certains critiques, par amertume ou désespoir, essaient d'abord d'éteindre le feu qui couve dans certains livres, d'autres, au contraire, prennent le risque de le lire, de s'en trouver choqués ou bouleversés, et peut-être brûlés par ce qu'ils lisent. C'est le cas de la critique empathique telle qu'elle est pratiquée, par exemple, par Jean-Louis Kuffer, Alain Bagnoud, Jean-François Fournier, Jacques Sterchi ou quelques autres, dont Contessa Pinon.