 Ils sont nombreux, les doubles de Philip Roth, sans doute le plus grand écrivain américain vivant : il y a Portnoy (et son célèbre complexe), Zuckermann (l’écrivain fantôme) et David Kepesh, professeur de littérature à l’Université — mais surtout de désir. Après une longue absence, celui-ci revient dans un roman magnifique et bouleversant, La Bête qui meurt.*
Ils sont nombreux, les doubles de Philip Roth, sans doute le plus grand écrivain américain vivant : il y a Portnoy (et son célèbre complexe), Zuckermann (l’écrivain fantôme) et David Kepesh, professeur de littérature à l’Université — mais surtout de désir. Après une longue absence, celui-ci revient dans un roman magnifique et bouleversant, La Bête qui meurt.*
David Kepesh, proche aujourd’hui de la soixantaine, tombe amoureux d’une étudiante de vingt-quatre ans, fille de riches émigrés cubains, qui l’émeut et le fascine par l’opulence de ses appas. Ils vont s’aimer, se séparer, puis la belle Consuela réapparaîtra dans la vie de David Kepesh, huit ans plus tard, pour des retrouvailles érotiques et funèbres. À partir de cette trame, Roth va disséquer les sentiments, décrypter les ruses du désir, méditer sur les affres du temps qui passe et livrer une radiographie incroyablement juste de notre époque étouffée par la bien-pensance et les mensonges rassurants. Au commencement est le désir, telle est la loi de l’espèce, désir qui n’est pas l’art du flirt ou de la séduction « à la française », mais justement « l’impératif sauvage », scandaleux, inacceptable. Un désir qui entraîne les amants loin d’eux-mêmes : « on plonge dans le chaos de l’éros et la déstabilisation radicale ». Pas de truquage possible dans une relation où la domination change de camp en permanence, où l’on vit constamment en porte-à-faux. Bien qu’il soit un maître du genre (c’est, du moins, ce qu’il se plaît à croire), David Kepesh est entraîné dans un tourbillon qui va balayer toutes ses certitudes et le laisser, une fois Consuela partie, face à lui-même, c’est-à-dire à la mort.
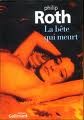 C’est la deuxième partie du roman, pendant laquelle Roth revient sur les années soixante : la Pilule, l’Herbe, Little Richard, le Dr Spock, et même « Glenn Miller qui arrivait à lubrifier la situation autant que faire se peut ». La folle libération des années peace and love au cours desquelles « les avances du mâle n’étaient pas pour les femmes un délit à dénoncer et sanctionner, mais un signal sexuel auquel il était loisible de répondre ». Le sexe était le grand initiateur aux mystères du monde. Kepesh évoque alors quelques-unes des maîtresses de cette époque, Janie Wyatt, la féministe convaincue, et Carolyn Lyons, autre femme généreusement dotée. Il s’arrête aussi sur le destin pitoyable de son fils Kenny, qui a suivi le droit chemin, études banales, université sans gloire, puis petite entreprise de restauration de tableaux (comme sa mère !). Aux yeux de son père, Kenny incarne toute la platitude et le conformisme des années 90 : un désir régressif et timide qui n’ose pas affronter l’âge adulte — c’est-à-dire la perte et le chaos, le désir tout-puissant.
C’est la deuxième partie du roman, pendant laquelle Roth revient sur les années soixante : la Pilule, l’Herbe, Little Richard, le Dr Spock, et même « Glenn Miller qui arrivait à lubrifier la situation autant que faire se peut ». La folle libération des années peace and love au cours desquelles « les avances du mâle n’étaient pas pour les femmes un délit à dénoncer et sanctionner, mais un signal sexuel auquel il était loisible de répondre ». Le sexe était le grand initiateur aux mystères du monde. Kepesh évoque alors quelques-unes des maîtresses de cette époque, Janie Wyatt, la féministe convaincue, et Carolyn Lyons, autre femme généreusement dotée. Il s’arrête aussi sur le destin pitoyable de son fils Kenny, qui a suivi le droit chemin, études banales, université sans gloire, puis petite entreprise de restauration de tableaux (comme sa mère !). Aux yeux de son père, Kenny incarne toute la platitude et le conformisme des années 90 : un désir régressif et timide qui n’ose pas affronter l’âge adulte — c’est-à-dire la perte et le chaos, le désir tout-puissant.
Il ne faut surtout pas déflorer la troisième partie du roman de Philip Roth : elle est inattendue et bouleversante. Nous sommes au seuil du nouveau millénaire et tout a changé autour de David Kepesh et en lui-même. « Le désordre du monde est un désordre sous surveillance, ponctué d’entractes pour vendre des voitures. La télé fait ce qu’elle sait faire de mieux : elle accomplit le triomphe de la banalisation sur la tragédie, le triomphe de la Surface. » David va retrouver Consuela et tomber à nouveau sous son charme. Mais le désir a changé de visage : triomphant, impérieux et sauvage autrefois, il prend les traits aujourd’hui d’un ange de la mort qui invitera David à le suivre.
* Philip Roth, La Bête qui meurt, Folio.